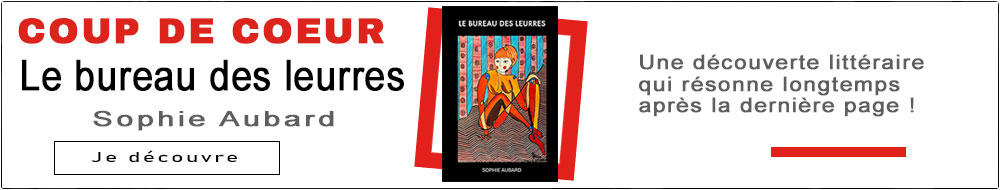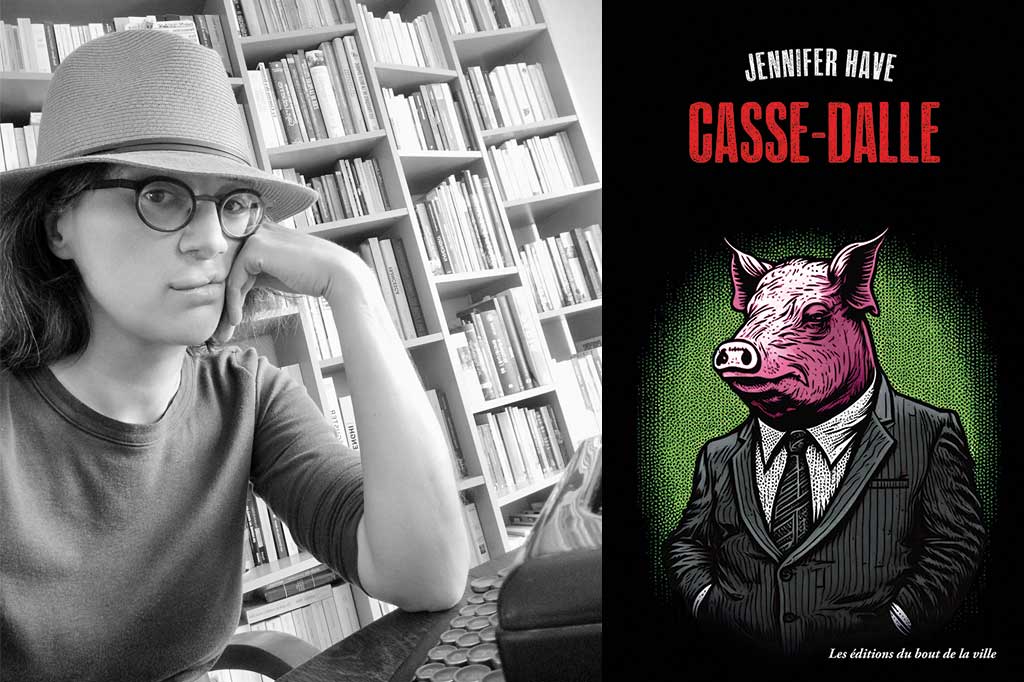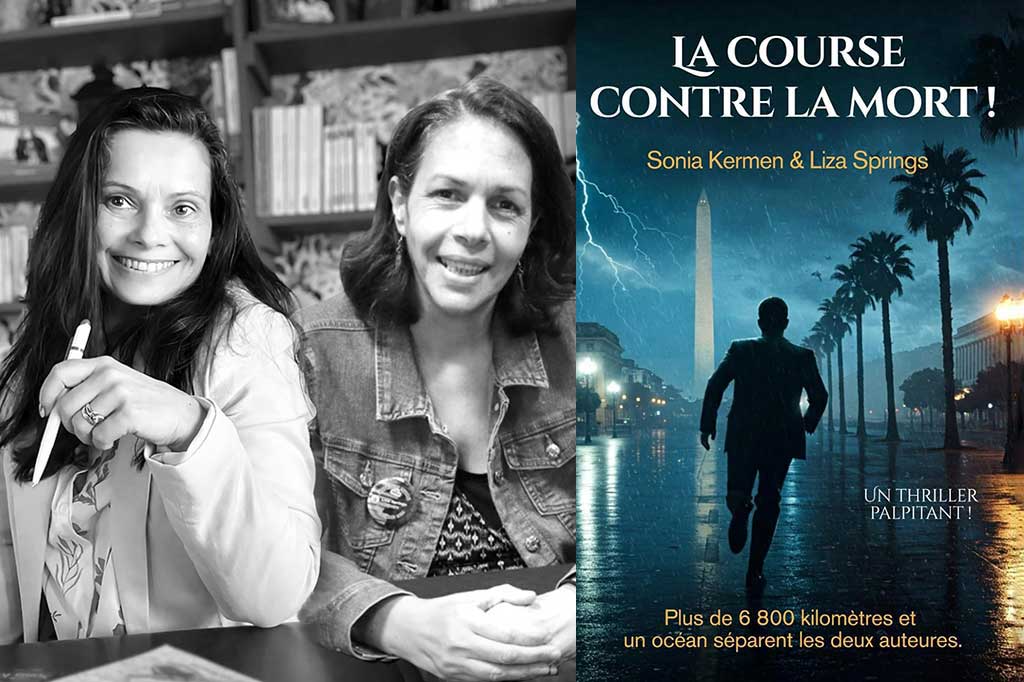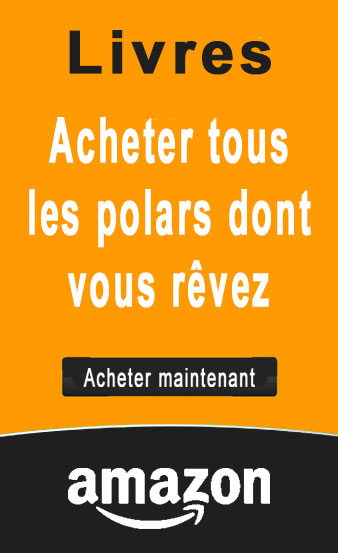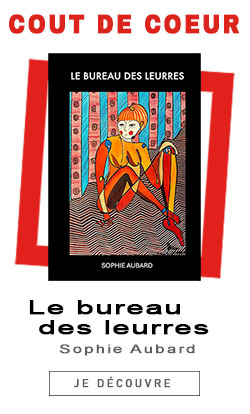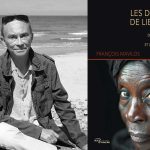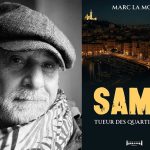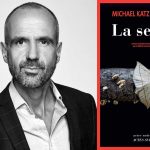Un narrateur au cœur des ténèbres
Fabrice Castanet orchestre dans « Entre les gouttes » un exercice narratif d’une audace remarquable : donner la parole à un protagoniste dont la psyché dévoile progressivement ses abysses les plus troublants. Antoine Perrin, vétérinaire en apparence rangé, devient sous la plume de l’auteur un narrateur à la première personne dont la voix nous entraîne dans les méandres d’une conscience fragmentée. Cette approche narrative, loin de se contenter d’un simple effet de style, constitue le véritable moteur dramatique du récit, transformant chaque page en une exploration psychologique où le lecteur se trouve pris au piège d’une intimité dérangeante.
La force du roman réside dans cette capacité à maintenir un équilibre précaire entre fascination et répulsion. Castanet évite l’écueil du sensationnalisme en construisant un personnage d’une complexité saisissante, dont les pensées oscillent entre banalité quotidienne et pulsions destructrices. Le narrateur se révèle tour à tour cynique observateur de la société contemporaine, père aimant en détresse, et individu aux instincts les plus sombres. Cette polyphonie interne crée une tension narrative constante, où chaque confidence du protagoniste devient un piège tendu au lecteur, l’obligeant à naviguer entre empathie et rejet.
L’auteur déploie une écriture qui épouse parfaitement les contorsions mentales de son personnage principal. Les digressions d’Antoine, ses rationalisations tortueuses et ses moments de lucidité brutale s’enchaînent dans un flux de conscience maîtrisé, révélant progressivement les failles d’une personnalité en déliquescence. Cette technique narrative immersive transforme la lecture en une expérience troublante, où l’on découvre les rouages d’un esprit capable de justifier l’injustifiable tout en conservant une façade de respectabilité bourgeoise.
Le génie de Castanet transparaît dans sa capacité à rendre crédible et même parfois attachant un personnage fondamentalement antipathique. Antoine Perrin devient le miroir déformant d’une certaine masculinité contemporaine, avec ses frustrations, ses échecs relationnels et sa violence latente. Cette construction narrative audacieuse place le lecteur dans une position d’inconfort salutaire, l’obligeant à questionner ses propres mécanismes d’identification et de jugement moral, tout en maintenant un suspense psychologique d’une intensité remarquable.
le livre de Fabrice Castanet à acheter
La construction d’une amitié empoisonnée
L’un des aspects les plus saisissants du roman de Castanet réside dans sa peinture acide des relations amicales universitaires et de leur évolution au fil des décennies. Le « groupe des prolos », cette appellation ironique que s’attribuent les étudiants vétérinaires d’origine modeste, devient le terrain d’observation privilégié pour explorer les dynamiques toxiques qui peuvent gangrener les liens les plus intimes. L’auteur dessine avec une précision chirurgicale les mécanismes de pouvoir, de manipulation et de ressentiment qui transforment progressivement une camaraderie estudiantine en un réseau de tensions sourdes et de non-dits explosifs.
Castanet excelle dans l’art de révéler comment les blessures d’amour-propre et les frustrations personnelles peuvent empoisonner durablement des relations en apparence solides. Chaque personnage du groupe porte en lui les germes de ses propres contradictions : Sandra la communiste devenue bourgeoise, Alain l’ambitieux rongé par ses secrets, Cédric le sportif enfermé dans ses regrets. Ces portraits nuancés évitent l’écueil de la caricature pour offrir une galerie de personnages aux motivations complexes, dont les failles psychologiques s’entrechoquent dans un jeu de miroirs déformants particulièrement efficace.
La correspondance entre les anciens amis, savamment distillée tout au long du récit, constitue un procédé narratif d’une grande habileté. Ces lettres et messages deviennent les fragments d’un puzzle psychologique où se dessinent les contours d’amitiés corrompues par le temps et les circonstances. L’auteur utilise ces échanges épistolaires pour révéler progressivement les zones d’ombre du passé commun, transformant chaque missive en indice potentiel et chaque confidence en arme à double tranchant.
Cette exploration des relations humaines dégradées trouve son apogée dans la façon dont Castanet dépeint l’isolement croissant de son protagoniste au sein même du groupe. Antoine Perrin découvre avec amertume que ses « amis » ne l’ont jamais véritablement apprécié, révélation qui cristallise ses ressentiments et nourrit sa paranoïa grandissante. Cette dimension sociologique du roman, loin de se limiter à une simple chronique de la désillusion, interroge plus largement les mécanismes de l’exclusion et de la violence symbolique qui peuvent germer au cœur des relations les plus anciennes.
Le poids du passé étudiant
Le séjour dans le parc du Mercantour constitue l’épicentre traumatique autour duquel gravite toute la mécanique narrative de Castanet. Cette parenthèse estudiantine, qui devait marquer l’apogée de l’amitié du groupe, se transforme en catalyseur des tensions latentes et en révélateur des véritables caractères. L’auteur manie avec subtilité la technique du flash-back pour dévoiler progressivement les événements de cette nuit fatale, créant un effet de kaléidoscope temporel où chaque fragment de souvenir vient éclairer d’un jour nouveau les relations présentes.
L’évocation de l’école vétérinaire toulousaine dépasse la simple reconstitution d’époque pour devenir le laboratoire d’observation des rapports de classe et des mécanismes d’exclusion sociale. Castanet peint avec justesse l’atmosphère de cette institution où se côtoient fils de bourgeois et étudiants d’origine modeste, créant des fractures invisibles mais durables. Le bizutage, les codes sociaux implicites et la violence symbolique exercée par certains groupes dominants dessinent en filigrane un portrait critique du milieu universitaire des années 90, sans jamais sombrer dans la nostalgie complaisante ou la dénonciation systématique.
La tragédie de François, cet accident aux contours flous qui hante les souvenirs de chacun, illustre magistralement la capacité de l’auteur à distiller l’information narrative. Les versions contradictoires, les zones d’ombre et les témoignages lacunaires transforment cet épisode en véritable chambre d’écho où résonnent culpabilité, mensonges et remords. Cette approche fragmentaire du récit rétrospectif permet à Castanet d’explorer les mécanismes de la mémoire sélective et de la reconstruction a posteriori des événements traumatisants.
L’habileté de l’écrivain transparaît dans sa façon de montrer comment ce passé commun, loin de souder définitivement le groupe, devient progressivement un poison qui ronge chaque relation. Les secrets partagés se muent en chantages implicites, les souvenirs heureux en reproches tacites, et l’amitié d’antan en masque social maintenu par habitude plus que par affection véritable. Cette dégradation progressive des liens humains, observée sur plusieurs décennies, offre une réflexion mélancolique sur l’impossibilité de préserver intact l’idéal de la jeunesse face aux compromissions de l’âge adulte.
Une écriture au service de la tension psychologique
Castanet déploie une technique narrative qui transforme chaque page en un exercice d’équilibrisme entre révélation et dissimulation. Son style épouse parfaitement les méandres d’une conscience trouble, alternant entre moments de lucidité glaçante et passages où la rationalisation côtoie le déni. L’auteur parvient à maintenir un rythme soutenu grâce à une alternance habile entre dialogues incisifs et monologues intérieurs, créant une dynamique textuelle qui mime les soubresauts d’un esprit en proie à ses contradictions. Cette approche stylistique permet de restituer avec authenticité la complexité psychologique du protagoniste sans jamais verser dans la complaisance.
Le maniement du temps narratif révèle une maîtrise certaine des codes du thriller psychologique. Les analepses surgissent au moment opportun pour éclairer d’un jour nouveau les actions présentes, tandis que les ellipses ménagent des zones d’ombre propices au suspense. L’écrivain joue subtilement avec les attentes du lecteur en distillant les informations capitales par fragments, créant un effet de puzzle dont chaque pièce vient modifier la perception d’ensemble. Cette construction en spirale, où le passé rattrape inexorablement le présent, confère au récit une dimension tragique particulièrement efficace.
L’usage de la correspondance comme révélateur psychologique témoigne d’une approche originale du genre. Ces lettres et messages, intercalés dans la narration principale, fonctionnent comme autant de miroirs déformants qui renvoient au protagoniste une image de lui-même qu’il refuse souvent d’accepter. Castanet exploite intelligemment ce procédé épistolaire pour créer des effets d’ironie dramatique, le lecteur découvrant progressivement l’écart entre la perception que le narrateur a de lui-même et celle qu’en ont ses proches.
La force du roman réside également dans sa capacité à maintenir une ambiguïté constante sur la fiabilité du narrateur. L’auteur parsème le récit d’indices contradictoires et de versions divergentes des événements, obligeant le lecteur à adopter une posture critique face aux confidences du protagoniste. Cette technique, héritée des maîtres du roman noir, permet à Castanet d’explorer les mécanismes de l’auto-justification et du mensonge à soi-même, tout en préservant jusqu’aux dernières pages l’incertitude nécessaire au maintien de la tension narrative.
Les meilleurs livres à acheter
Le milieu vétérinaire comme toile de fond
L’expertise professionnelle de Fabrice Castanet transparaît dans sa capacité à ancrer son récit dans l’univers vétérinaire contemporain sans jamais transformer son roman en simple chronique corporatiste. L’auteur dessine les contours d’une profession en mutation, prise entre vocation traditionnelle et contraintes économiques modernes, où les cliniques indépendantes cèdent progressivement le terrain aux groupes financiers. Cette contextualisation socio-économique enrichit considérablement la psychologie du protagoniste, dont les frustrations professionnelles nourrissent ses ressentiments plus profonds. La peinture du quotidien d’Antoine Perrin, entre consultations routinières et urgences nocturnes, révèle un praticien désabusé pour qui l’exercice médical n’est plus qu’une succession d’automatismes vidés de leur sens initial.
Le choix de ce milieu professionnel s’avère particulièrement pertinent pour explorer les thématiques centrales du roman. La familiarité du vétérinaire avec la mort, la souffrance et les gestes techniques de dissection crée un terreau narratif fertile où la violence peut surgir avec une inquiétante naturalité. Castanet exploite intelligemment cette proximité avec l’anatomie et les substances chimiques pour tisser des liens troublants entre l’exercice médical légitime et les dérives criminelles de son personnage. Cette ambivalence permanente entre soin et destruction, guérison et élimination, confère au récit une dimension symbolique qui dépasse la simple intrigue policière.
L’évocation des relations interprofessionnelles révèle également les talents d’observateur social de l’auteur. Les rapports tendus entre associés, les rivalités commerciales et les compromissions morales dessinent un portrait sans fard d’un secteur soumis aux mêmes pressions que l’ensemble de l’économie contemporaine. Ces détails professionnels, loin de constituer un simple décor réaliste, participent activement à la construction psychologique du protagoniste en montrant comment l’exercice quotidien du pouvoir médical peut nourrir des pulsions de domination plus larges.
La connaissance intime du milieu permet à Castanet d’éviter les clichés habituels sur la profession vétérinaire tout en explorant ses zones d’ombre spécifiques. L’isolement géographique de certaines pratiques rurales, la solitude des gardes nocturnes et l’accès privilégié à des substances létales constituent autant d’éléments narratifs que l’auteur manie avec subtilité. Cette authenticité professionnelle renforce la crédibilité d’ensemble du roman tout en offrant un éclairage original sur les dérives possibles d’une profession traditionnellement associée à la bienveillance et au soin.
Les mécanismes de la manipulation narrative
Castanet orchestre un véritable jeu de dupes avec son lecteur, déployant une stratégie narrative où chaque révélation modifie rétroactivement la perception des événements antérieurs. L’auteur exploite habilement les zones aveugles de la narration à la première personne pour créer des effets de surprise qui ne relèvent jamais de l’artifice gratuit. Le protagoniste devient ainsi un narrateur peu fiable dont les omissions, rationalisations et distorsions de la réalité constituent autant de pièges tendus au lecteur. Cette technique, héritée des maîtres du roman noir américain, trouve ici une application particulièrement sophistiquée qui maintient l’incertitude jusqu’aux dernières pages.
L’introduction progressive de la lieutenante Duc constitue un exemple remarquable de construction dramatique. Son apparition dans le récit fonctionne comme un révélateur chimique qui fait émerger les contradictions et mensonges du narrateur. Castanet parvient à transformer chaque interrogatoire en duel psychologique où s’affrontent deux intelligences, créant une tension dramatique qui transcende le simple cadre de l’enquête policière. Cette dynamique relationnelle permet à l’auteur d’explorer les mécanismes de la culpabilité et de la projection tout en maintenant le suspense sur l’identité véritable du coupable.
Le dosage de l’information constitue sans doute l’atout majeur de cette construction narrative. L’écrivain distille les indices avec une parcimonie calculée, alternant fausses pistes et révélations partielles dans un crescendo savamment orchestré. Chaque chapitre apporte sa pierre à l’édifice tout en préservant l’équilibre fragile entre clarification et mystère. Cette maîtrise du rythme narratif évite l’écueil de la surexplication tout en offrant au lecteur attentif les clés nécessaires à une compréhension progressive des enjeux véritables.
La correspondance entre les personnages fonctionne comme un dispositif narratif particulièrement astucieux, permettant à l’auteur de révéler des informations capitales tout en préservant la cohérence du point de vue adopté. Ces documents épistolaires, présentés comme des preuves tangibles, créent une illusion de vérité qui renforce l’efficacité de la manipulation narrative. Castanet joue subtilement sur cette apparente objectivité documentaire pour mieux égarer son lecteur, transformant chaque lettre en pièce à conviction potentielle dans un puzzle dont les contours véritables ne se révèlent qu’au terme du parcours initiatique proposé.
Entre polar et étude de caractère
Fabrice Castanet transcende les frontières génériques traditionnelles en proposant un roman qui emprunte autant au thriller psychologique qu’à l’analyse comportementale. L’intrigue policière, structurée autour de la disparition progressive des membres du groupe d’amis, sert de prétexte à une exploration plus profonde des ressorts de la violence ordinaire. L’auteur évite soigneusement les codes convenus du polar classique pour privilégier une approche intimiste où les révélations externes importent moins que les découvertes intérieures. Cette hybridation générique permet d’offrir aux amateurs d’énigmes criminelles un suspense efficace tout en satisfaisant les lecteurs en quête d’approfondissement psychologique.
L’enquête menée par la lieutenante Duc fonctionne davantage comme un miroir tendu au protagoniste que comme une véritable investigation policière. Les interrogatoires deviennent des séances d’introspection forcée où Antoine Perrin se trouve confronté à ses propres contradictions et mensonges. Castanet utilise intelligemment cette dynamique pour révéler les mécanismes de défense d’une personnalité pathologique sans jamais verser dans l’exposition didactique. Le face-à-face entre l’enquêtrice et le suspect principal génère une tension dramatique qui dépasse largement le cadre procédural habituel pour toucher aux fondements mêmes de l’identité narrative.
La véritable réussite du roman réside dans cette capacité à faire coexister plusieurs niveaux de lecture sans que l’un nuise à l’autre. Les amateurs de romans d’atmosphère y trouveront une peinture corrosive de la bourgeoisie provinciale contemporaine, tandis que les lecteurs attirés par l’analyse caractérielle découvriront un cas d’étude fascinant sur les mécanismes de la culpabilité et de la rationalisation. Cette richesse thématique évite l’écueil de la spécialisation excessive tout en préservant la cohérence d’ensemble nécessaire à l’efficacité narrative.
L’originalité de l’approche de Castanet tient également à sa façon de détourner les attentes du genre policier. Plutôt que de se concentrer sur l’élucidation méthodique d’un mystère, l’auteur privilégie l’exploration des zones grises de la moralité humaine et des compromissions quotidiennes qui peuvent mener aux extrêmes. Cette dimension sociologique du récit, nourrie par une observation attentive des comportements contemporains, élève le propos au-delà du simple divertissement pour proposer une réflexion plus large sur les dérives possibles de l’individualisme moderne et de ses frustrations.
Les meilleurs livres à acheter
Une œuvre qui interroge la nature humaine
Au terme de ce parcours littéraire, « Entre les gouttes » s’impose comme une interrogation dérangeante sur la banalité du mal et les mécanismes de basculement qui peuvent transformer un individu ordinaire en prédateur. Castanet évite l’écueil de la diabolisation facile pour proposer un portrait complexe d’un homme dont les dérives s’enracinent dans des frustrations et des blessures parfaitement compréhensibles. Cette approche nuancée du personnage principal permet d’explorer les zones grises de la moralité sans jamais excuser l’inexcusable, créant un malaise salutaire qui pousse le lecteur à s’interroger sur ses propres mécanismes de jugement et d’identification.
L’auteur déploie une réflexion particulièrement subtile sur les rapports de domination et les violences symboliques qui traversent les relations sociales contemporaines. La misogynie latente du protagoniste, ses préjugés de classe et son mépris pour autrui révèlent les ressorts profonds d’une masculinité toxique dont les manifestations dépassent largement le cadre du fait divers. Cette dimension sociologique du roman, portée par une observation fine des comportements et des discours, confère à l’œuvre une portée qui transcende le simple cadre du thriller pour toucher aux questionnements les plus actuels sur les rapports de genre et de pouvoir.
Le traitement de la culpabilité et du remords constitue l’un des aspects les plus aboutis de cette exploration psychologique. Castanet montre avec une précision clinique comment un esprit peut rationaliser ses actes les plus condamnables tout en préservant une image valorisante de lui-même. Cette capacité d’auto-aveuglement, rendue crédible par la construction narrative, éclaire d’un jour inquiétant les mécanismes de déni qui permettent la perpétuation de cycles de violence. L’auteur parvient ainsi à questionner la notion même de responsabilité individuelle sans jamais verser dans le relativisme moral.
« Entre les gouttes » s’achève sur une note ambiguë qui refuse les conclusions définitives et les jugements tranchés. Cette ouverture finale, loin de constituer une faiblesse narrative, témoigne de la maturité littéraire de Castanet qui préfère laisser son lecteur face à ses propres questionnements plutôt que de lui imposer une morale préfabriquée. Le roman fonctionne ultimement comme un miroir tendu à notre époque, révélant les failles et les contradictions d’une société qui peine à concilier ses aspirations humanistes avec la réalité de ses comportements quotidiens. Cette capacité à susciter l’inconfort intellectuel tout en maintenant l’efficacité narrative place l’œuvre parmi les réussites notables de la littérature contemporaine française.
Mots-clés : Thriller psychologique, Narrateur non-fiable, Milieu vétérinaire, Amitié toxique, Violence ordinaire, Manipulation narrative, Nature humaine
Extrait Première Page du livre
» Chapitre 1
Je lui demandai pourquoi il avait cru bon de garder toutes ces lettres durant tant d’années.
Il me répondit dans son style ampoulé si caractéristique, qu’il avait toujours eu un côté fétichiste.
— Et puis, ajouta-t-il, vous étiez mes seuls amis ! Figure-toi que je ne n’avais aucun ami avant d’intégrer l’école vétérinaire. Et je ne m’en suis pas fait de nouveau, depuis ! Je sais que tu vas probablement trouver ça idiot, disons, ridicule, mais quelque part, de conserver religieusement toute nouvelle de chacun d’entre vous me permettait de vous avoir toujours auprès de moi. Même quand vous étiez à des centaines ou des milliers de kilomètres d’ici, fit-il en me montrant le volumineux tas de lettres et autres cartes postales qui trônaient sur son bureau.
Ses amis ?
Eux, peut-être.
Pour moi, il n’était qu’un caillou dans ma chaussure.
Je ne l’avais jamais vraiment apprécié. Je ne comprenais pas ce que les autres pouvaient bien lui trouver.
OK, vu ses origines, ce nabot avait gagné le droit d’intégrer le groupe des vétos prolos. C’est le nom que s’était donné notre petit clan d’étudiants dont chaque membre était d’extraction modeste, vous l’aurez compris ! On n’était pas très nombreux alors, il faut bien le dire ! Beaucoup d’élèves étaient issus de milieux privilégiés et pourtant, à l’époque, les études vétérinaires ne coutaient pas grand-chose. Il n’existait pas, comme aujourd’hui, d’école vétérinaire privée à quatre-vingt-dix mille euros les frais de scolarité !
On formait un clan comme il en existait tant d’autres au sein de l’établissement. Il y avait Christophe, donc, qui s’accrochait à nous comme du chiendent. Il y avait l’impétueuse Sandra, qui faisait battre tous les cœurs, cette grosse tête d’Alain, le petit couple sympa Alexandra-Cédric et aussi le sarcastique Antoine. Et François, l’idéaliste. Notre groupe s’était constitué naturellement, comme une évidence. D’aucuns y verraient une certaine incapacité à s’extraire de notre classe sociale.
À vrai dire, j’aurais eu bien du mal à m’acoquiner avec certains des fils et filles à papa qui pullulaient dans l’établissement. Même s’ils avaient daigné m’accorder, ne serait-ce qu’un regard. «
- Titre : Entre les gouttes
- Auteur : Fabrice Castanet
- Éditeur : Éditions Polar passion
- Nationalité : France
- Date de sortie : 2025
Résumé
Antoine, un vétérinaire de campagne, entame une course folle pour détruire certaines preuves, dont il est persuadé qu’elles sont détenues dans des courriers échangés entre ses amis de l’école vétérinaire. Le groupe des prolos. Entre parano, désespoir et cynisme, une improvisation meurtrière se croque sur une feuille vieillie par vingt années de doute. C’est un aller sans retour, une destruction systémique et désillusionnée visant à effacer une part sombre de son passé. Et quelle part ! Un premier roman noir de Fabrice Castanet. Haletant, déstabilisant, fascinant.

Je m’appelle Manuel et je suis passionné par les polars depuis une soixantaine d’années, une passion qui ne montre aucun signe d’essoufflement.