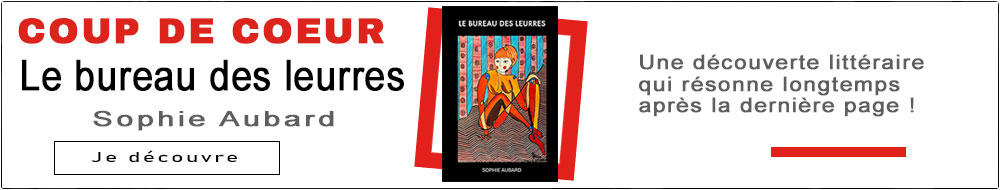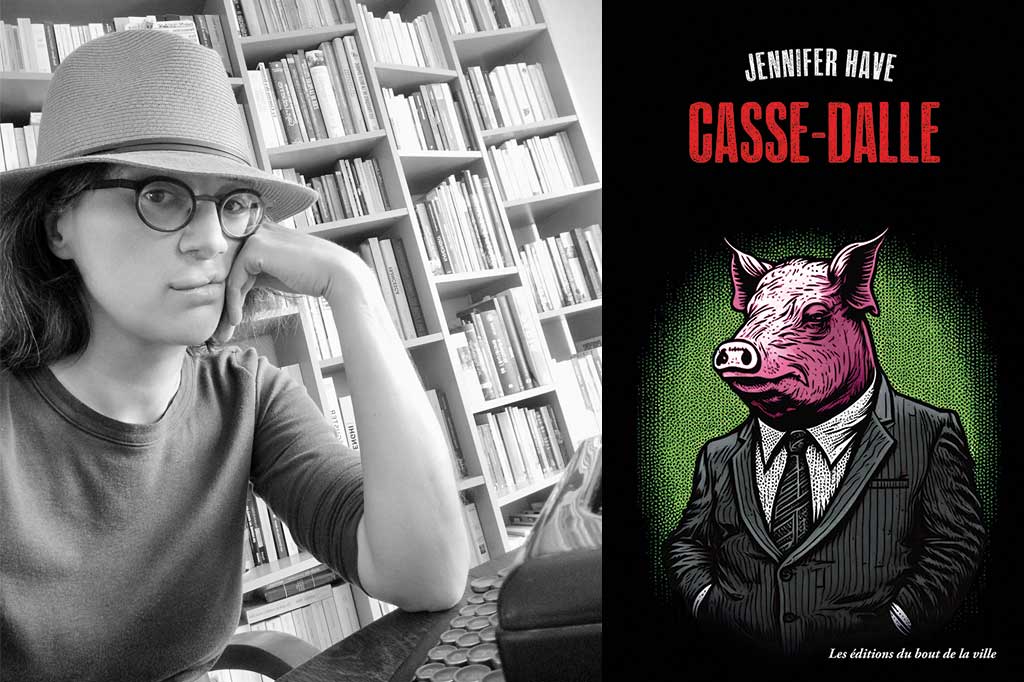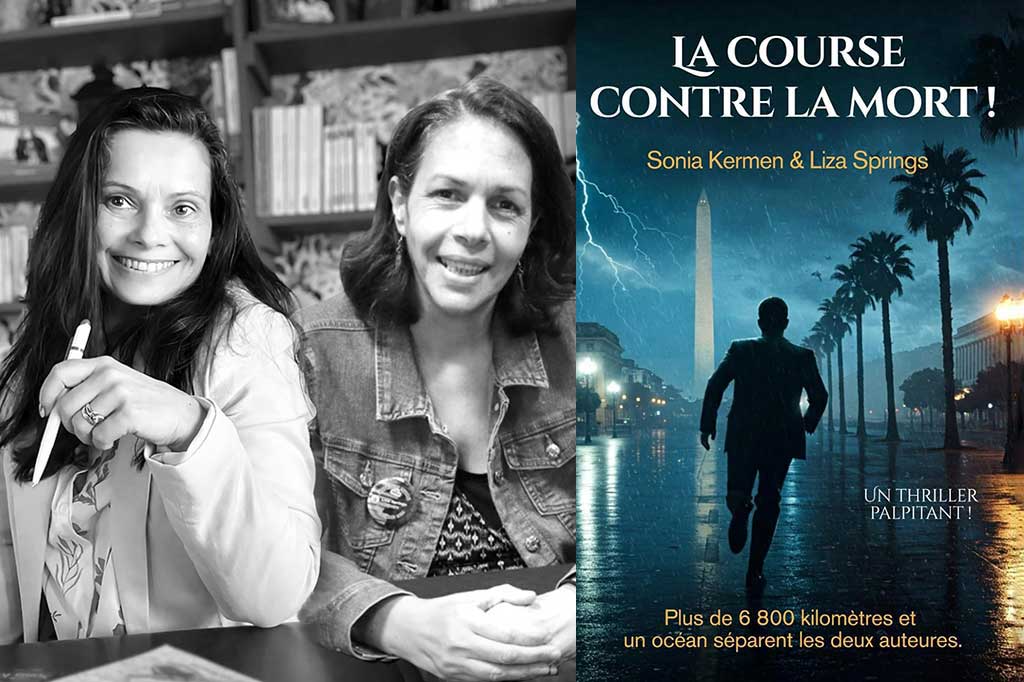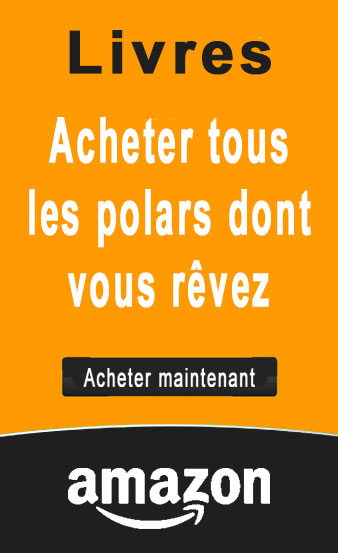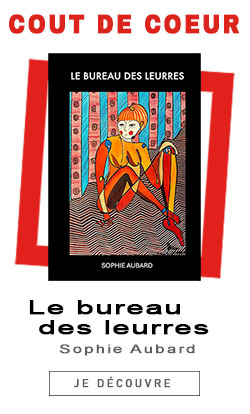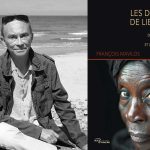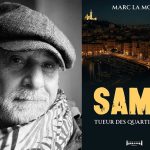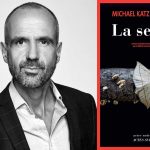Un témoignage de l’intérieur
Marc La Mola nous propulse d’emblée dans les entrailles d’un monde habituellement hermétique aux regards extérieurs. L’auteur, fort de son expérience d’ancien policier dans les quartiers nord marseillais, franchit une frontière rarement traversée : celle qui sépare le chasseur de sa proie. Cette transgression narrative constitue l’épine dorsale de l’ouvrage, transformant ce qui aurait pu être un énième récit sensationnaliste en une plongée anthropologique saisissante. La légitimité de La Mola ne repose pas uniquement sur son passé professionnel, mais sur sa capacité à dépasser les clivages traditionnels pour établir un dialogue avec celui qui fut jadis son adversaire.
Le dispositif narratif choisi révèle toute sa puissance dans cette confrontation des perspectives. Samir, le personnage central, n’est pas un simple informateur mais devient le co-constructeur d’un récit où se mêlent confession et analyse sociologique. L’ancien enquêteur endosse ici un rôle inédit : celui de confesseur laïc recueillant les fragments d’une existence façonnée par la violence et l’économie parallèle. Cette proximité troublante entre les deux protagonistes génère une tension dramatique constante, où la méfiance mutuelle cède progressivement la place à une forme d’intimité paradoxale.
La force du témoignage réside dans cette authenticité brute qui transpire de chaque page. La Mola ne se contente pas de retranscrire les paroles de Samir ; il nous fait pénétrer dans l’intimité de leurs rencontres clandestines, nous rendant témoins de l’évolution psychologique des deux hommes. Les silences, les hésitations, les moments de violence verbale ponctuent un récit où l’humanité affleure malgré l’horreur des faits relatés. Cette dimension testimoniale transforme le lecteur en observateur privilégié d’un huis clos où se révèlent les ressorts intimes de la criminalité organisée.
L’originalité de l’approche tient également à ce renversement des codes habituels du genre. Plutôt que de maintenir une distance sécurisante avec son sujet, l’auteur assume pleinement sa position d’ancien adversaire devenu confident. Cette proximité dangereuse, qu’il questionne lui-même tout au long du récit, offre une profondeur psychologique rare à un témoignage qui aurait pu sombrer dans le voyeurisme. La Mola parvient ainsi à transcender le simple compte-rendu factuel pour livrer une œuvre où l’introspection personnelle enrichit constamment la compréhension du phénomène social décrit.
livres de Marc La Mola à acheter
La construction d’un parcours criminel
L’architecture narrative de Marc La Mola révèle sa maîtrise dans la façon dont il déploie progressivement la genèse criminelle de Samir. Loin de céder à la tentation du sensationnel, l’auteur orchestre une montée en puissance calculée, où chaque révélation s’ancre dans un terreau social minutieusement décrit. Le parcours de Samir se dessine comme une tragédie moderne, où les déterminismes sociaux s’entremêlent aux choix individuels pour composer un destin qui semble à la fois inéluctable et scandaleusement évitable. Cette progression dramatique transforme ce qui pourrait n’être qu’une succession d’anecdotes criminelles en une véritable anatomie de la dérive sociale.
La force de La Mola réside dans sa capacité à contextualiser chaque étape de l’ascension criminelle sans jamais verser dans l’excuse ou la complaisance. L’enfance de Samir, marquée par la violence paternelle et l’effacement maternel, ne devient pas un alibi mais un élément d’explication parmi d’autres. L’auteur démontre comment l’environnement familial dysfonctionnel s’articule avec l’écosystème de la cité pour créer un terreau propice à l’émergence d’une personnalité criminelle. Cette approche nuancée évite les écueils du déterminisme social absolu tout en soulignant le poids des conditions objectives sur les trajectoires individuelles.
L’évolution hiérarchique de Samir au sein des réseaux de trafic révèle une logique entrepreneuriale perverse qui fascine autant qu’elle dérange. La Mola décrypte avec précision les codes de cette économie parallèle, où l’intelligence stratégique et la capacité de violence s’équilibrent dans une course permanente au pouvoir. Le passage du simple guetteur au chef de réseau s’opère selon des règles implacables que l’auteur expose sans fard, révélant une société dans la société avec ses propres codes d’honneur dévoyés et ses mécanismes de sélection brutaux.
La transformation psychologique du personnage constitue peut-être l’aspect le plus troublant de cette construction narrative. La Mola parvient à saisir le moment précis où l’homme ordinaire bascule vers l’inhumain, où la nécessité supposée de survie légitime l’irréparable. Cette métamorphose n’est ni glorifiée ni diabolisée, mais présentée comme le produit d’une logique systémique où la violence devient un outil de gestion parmi d’autres. Cette approche clinique, dépourvue de pathos, confère au récit une dimension quasi-documentaire qui renforce paradoxalement son impact émotionnel.
Méthodes narratives et immersion documentaire
L’hybridation générique constitue l’une des réussites les plus remarquables de cet ouvrage. Marc La Mola navigue avec habileté entre les codes du témoignage journalistique, de l’enquête policière et du récit littéraire, créant une forme narrative originale qui échappe aux classifications traditionnelles. Cette fluidité générique permet à l’auteur de puiser dans différents registres expressifs selon les nécessités du moment : la précision factuelle du rapport d’enquête côtoie l’introspection personnelle du mémorialiste, tandis que l’analyse sociologique enrichit le récit sans jamais l’alourdir. Cette plasticité formelle révèle une maîtrise technique qui transforme les contraintes du réel en ressources narratives.
La mise en scène des rencontres avec Samir constitue un choix esthétique particulièrement judicieux. L’auteur théâtralise ces face-à-face clandestins en exploitant leur dimension quasi-cinématographique : les lieux changeants, les précautions paranoïaques, l’atmosphère de menace latente participent d’une dramaturgie qui maintient la tension narrative tout en préservant l’authenticité du témoignage. Cette scénarisation ne relève jamais de l’artifice gratuit mais sert la compréhension psychologique des protagonistes. Les détails apparemment anecdotiques – les voitures de location, les rendez-vous dans la campagne provençale, les rituels de sécurité – révèlent autant les obsessions de Samir que les appréhensions de l’auteur.
L’alternance entre présent de l’enquête et passé recomposé génère un rythme narratif particulièrement efficace. La Mola maîtrise l’art du montage temporel, entrecroisant les séances de confession avec les souvenirs qu’elles libèrent, créant un effet de mise en abyme où le lecteur assiste simultanément à la construction du récit et à sa propre genèse. Cette technique permet d’éviter la linéarité chronologique traditionnelle des biographies criminelles pour privilégier une approche plus impressionniste, où les fragments du passé surgissent selon leur charge émotionnelle plutôt que selon leur ordre d’occurrence.
La gestion de la distance narrative révèle une conscience aiguë des enjeux éthiques du projet. L’auteur assume pleinement sa position d’ancien policier sans chercher à la masquer, mais il interroge constamment cette identité et ses implications sur la relation établie avec Samir. Cette réflexivité permanente enrichit le récit d’une dimension métanarritive qui évite l’écueil de la naïveté journalistique. La Mola ne dissimule ni ses doutes ni ses fascinations, transformant ses questionnements personnels en outils d’analyse qui éclairent autant le phénomène étudié que les mécanismes de sa propre investigation.
Portrait d’un monde en décomposition sociale
L’univers des quartiers nord marseillais se déploie sous la plume de La Mola comme un territoire à la géographie particulière, où les repères sociaux traditionnels ont cédé la place à une cartographie de la survie. L’auteur excelle dans sa capacité à restituer l’atmosphère de ces espaces urbains sans verser dans le pittoresque misérabiliste. Les tours de béton, les cages d’escalier souillées, les espaces verts transformés en zones de non-droit composent un décor que Samir habite comme un poisson dans l’eau, révélant combien l’environnement physique conditionne les possibilités d’existence. Cette géographie de l’abandon devient un personnage à part entière du récit, façonnant autant les destins individuels que les logiques collectives.
La désintégration du tissu social traditionnel trouve dans ce témoignage une illustration particulièrement saisissante. La Mola documente avec précision la disparition progressive des figures d’autorité légitimes – parents défaillants, école absente, services publics inexistants – laissant le champ libre à d’autres formes de régulation sociale. L’économie de la drogue ne s’impose pas seulement comme une activité lucrative mais comme un système de valeurs alternatif, avec ses hiérarchies, ses codes d’honneur pervertis et ses mécanismes de reconnaissance sociale. Cette substitution s’opère d’autant plus aisément qu’elle comble un vide institutionnel béant, offrant aux jeunes des quartiers une structure d’appartenance que la société légale leur refuse.
L’analyse de cette micro-société parallèle révèle des dynamiques complexes qui dépassent la simple opposition entre ordre et désordre. Samir évolue dans un univers régi par des règles strictes, où la violence n’est jamais gratuite mais toujours fonctionnelle, servant à maintenir un équilibre précaire entre des forces concurrentes. L’auteur parvient à décrypter cette logique interne sans la légitimer, montrant comment s’organise une économie souterraine dotée de ses propres codes déontologiques. Cette approche ethnographique éclaire les mécanismes par lesquels une société marginale développe ses propres institutions de régulation, révélant paradoxalement une forme d’ordre dans ce qui apparaît comme un chaos généralisé.
La dimension temporelle de cette décomposition sociale constitue l’un des apports les plus précieux de l’ouvrage. La Mola ne se contente pas de photographier une situation figée mais retrace l’évolution historique de ces quartiers, depuis leur construction utopique dans les années soixante-dix jusqu’à leur transformation en territoires de relégation. Cette perspective diachronique permet de comprendre comment s’articulent les facteurs structurels – désindustrialisation, chômage de masse, ségrégation urbaine – avec les dynamiques individuelles pour produire des trajectoires de marginalisation. Le témoignage de Samir s’inscrit ainsi dans une temporalité longue qui dépasse sa seule expérience personnelle pour révéler les mécanismes systémiques à l’œuvre dans la production de l’exclusion sociale.
Les meilleurs livres à acheter
La violence comme langage et territoire
Dans l’univers décrit par La Mola, la violence transcende sa dimension purement destructrice pour devenir un système de communication complexe. Samir manie les armes comme d’autres manient les mots, chaque acte violent portant un message précis destiné à ses pairs : affirmation de pouvoir, délimitation territoriale, ou simple rappel à l’ordre dans une hiérarchie fluctuante. L’auteur décode cette grammaire particulière avec la rigueur d’un anthropologue, révélant comment s’articulent les différents registres de cette violence codifiée. Cette approche analytique permet de dépasser l’horreur brute des faits pour comprendre leur fonction symbolique dans un écosystème où la parole a perdu sa force régulatrice au profit de l’acte sanglant.
L’économie de la violence révèle des logiques d’une rationalité glaçante que l’auteur parvient à exposer sans les cautionner. Chaque meurtre répond à un calcul précis : coût de l’inaction face aux risques de l’action, rapport de forces à établir, message à faire passer aux concurrents. Cette comptabilité macabre transforme l’existence en perpétuelle négociation où la mort d’autrui devient une variable d’ajustement dans la gestion des affaires. La Mola excelle à montrer comment cette rationalisation de l’homicide s’inscrit dans une logique entrepreneuriale perverse, où l’efficacité prime sur toute considération morale. Cette déshumanisation progressive du rapport à autrui constitue peut-être l’aspect le plus troublant du témoignage recueilli.
La territorialisation de l’espace urbain par la violence dessine une cartographie invisible mais omniprésente que seuls les initiés savent décrypter. Chaque coin de rue, chaque cage d’escalier devient l’enjeu de luttes intestines où se redéfinissent constamment les zones d’influence. L’auteur restitue avec précision cette géopolitique de proximité, montrant comment les quartiers se fragmentent en micro-territoires disputés selon des logiques qui échappent totalement aux autorités officielles. Cette balkanisation de l’espace social révèle l’émergence d’une souveraineté parallèle qui ne reconnaît d’autre légitimité que celle conférée par la force brute et la capacité d’intimidation.
La banalisation progressive de cette violence constitue l’un des phénomènes les plus inquiétants documentés par La Mola. Samir évoque ses crimes avec un détachement clinique qui révèle combien l’accoutumance à l’horreur transforme la perception du réel. Cette anesthésie émotionnelle ne relève pas du cynisme mais d’un mécanisme de survie psychologique dans un environnement où l’empathie devient un handicap mortel. L’auteur parvient à restituer cette logique interne sans jamais la justifier, révélant les ressorts psychologiques qui permettent à des individus ordinaires de franchir le seuil de l’irréparable et d’y installer leur quotidien.
Entre fiction et réalité : l’art du docu-fiction
La Mola assume pleinement l’ambiguïté générique de son entreprise dès l’avertissement liminaire, où il précise que les ressemblances avec des personnes existantes pourraient relever du hasard « ou pas ». Cette incertitude revendiquée constitue bien plus qu’une précaution juridique : elle révèle une stratégie narrative sophistiquée qui exploite les zones grises entre témoignage et reconstitution. L’auteur navigue consciemment dans cet entre-deux, utilisant les ressources de la fiction pour donner corps à une vérité documentaire parfois lacunaire. Cette hybridation permet de combler les silences du témoin, de reconstruire les scènes dont l’accès direct demeure impossible, tout en préservant l’authenticité du propos général.
L’utilisation de la fiction comme outil d’investigation révèle toute sa pertinence dans le traitement des zones d’ombre du témoignage. Samir ne peut ni ne veut tout dire, laissant des béances que l’auteur comble par un travail de reconstitution vraisemblable fondé sur son expérience policière et sa connaissance du terrain. Cette approche soulève des questions méthodologiques légitimes sur les limites de l’extrapolation narrative, mais elle permet également d’accéder à une vérité psychologique et sociologique que le simple compte-rendu factuel ne saurait atteindre. La fiction devient ici un instrument de compréhension plutôt qu’un masque déformant, révélant des mécanismes que la stricte objectivité journalistique peinerait à saisir.
La construction dramatique de certaines scènes révèle l’influence des codes cinématographiques sur l’écriture contemporaine du fait divers. Les rencontres nocturnes, les poursuites automobiles, les règlements de compte orchestrés avec un sens aigu de la mise en scène empruntent leur efficacité aux techniques narratives du thriller. Cette théâtralisation ne dessert pas la véracité du propos mais l’amplifie, transformant des faits bruts en séquences d’une intensité dramatique qui marque durablement l’imagination du lecteur. La Mola maîtrise cet équilibre délicat entre authenticité documentaire et efficacité narrative, prouvant que la recherche de vérité n’exclut pas nécessairement l’art de raconter.
L’enjeu éthique de cette démarche traverse l’ensemble de l’ouvrage sans jamais être totalement résolu. L’auteur interroge constamment sa propre position, ses motivations, les risques de dérive voyeuriste inhérents à son projet. Cette réflexivité permanente constitue paradoxalement l’une des garanties de crédibilité du récit, montrant un auteur conscient des enjeux moraux de son entreprise. La dimension fictionnelle du récit devient alors un moyen d’assumer pleinement la subjectivité de toute reconstitution narrative, plutôt qu’une tentative de dissimulation des approximations inévitables. Cette honnêteté méthodologique confère au docu-fiction une légitimité que pourrait lui envier bien des reportages prétendument objectifs.
Les enjeux sociologiques du témoignage
L’ouvrage de La Mola transcende le simple récit criminel pour s’ériger en document sociologique d’une richesse considérable. Le témoignage de Samir offre une fenêtre privilégiée sur les mécanismes de reproduction sociale dans les territoires relégués, révélant comment s’articulent échec scolaire, désintégration familiale et économie parallèle pour produire des trajectoires de marginalisation. L’auteur parvient à extraire de ce cas particulier des enseignements généralisables sur le fonctionnement des quartiers populaires, montrant comment l’absence d’alternatives légitimes oriente mécaniquement une partie de la jeunesse vers les trafics. Cette dimension heuristique transforme l’anecdote individuelle en révélateur des dysfonctionnements structurels de la société française contemporaine.
La question de la représentativité du témoignage mérite d’être interrogée avec nuance. Samir ne saurait incarner l’ensemble des jeunes des quartiers nord, et l’auteur prend soin de ne jamais généraliser abusivement son cas particulier. Cependant, la précision ethnographique du récit permet d’identifier des constantes sociologiques significatives : l’importance des réseaux de solidarité alternative, la centralité de l’économie souterraine, l’émergence de codes de régulation spécifiques. Ces éléments dessinent les contours d’une culture de survie qui dépasse largement l’expérience individuelle de Samir pour révéler l’existence d’un système social cohérent, doté de ses propres logiques de fonctionnement et de ses mécanismes de perpétuation.
L’analyse des processus de légitimation de la violence constitue l’un des apports les plus précieux de cette enquête. La Mola documente minutieusement la façon dont s’opère la normalisation de l’exceptionnel, comment des actes objectivement monstrueux deviennent acceptables dans un contexte donné. Cette naturalisation de la violence révèle l’existence de référentiels moraux alternatifs qui remettent en question l’universalité supposée des valeurs dominantes. L’auteur évite l’écueil du relativisme culturel tout en montrant comment s’élaborent des systèmes normatifs parallèles, questionnant implicitement l’efficacité des politiques d’intégration fondées sur l’adhésion à un modèle unique.
La portée critique de l’ouvrage réside également dans sa capacité à révéler les angles morts des politiques publiques. Le parcours de Samir illustre l’inefficacité des dispositifs traditionnels d’insertion face à des situations de marginalité extrême, soulignant l’inadéquation entre les outils disponibles et la réalité des besoins. Cette analyse en creux des défaillances institutionnelles confère au témoignage une dimension politique implicite, sans que l’auteur verse jamais dans la dénonciation militante. La force de démonstration naît de l’accumulation des faits plutôt que de l’argumentation explicite, laissant au lecteur le soin de tirer ses propres conclusions sur l’état de la cohésion sociale française.
Les meilleurs livres à acheter
Portée littéraire et questionnements contemporains
L’inscription de cet ouvrage dans le paysage littéraire français contemporain soulève des interrogations stimulantes sur l’évolution des formes narratives face aux mutations sociales. La Mola s’inscrit dans une lignée d’écrivains-témoins qui, de Céline à Carrère, ont cherché à saisir les transformations de leur époque à travers des parcours individuels emblématiques. Sa contribution spécifique réside dans cette capacité à investir un territoire narratif largement délaissé par la littérature légitime, celui des banlieues populaires et de leur violence endémique. Cette exploration des marges urbaines enrichit le corpus littéraire français d’une voix singulière, portée par une légitimité d’expérience rare dans le champ culturel dominant.
L’enjeu esthétique de l’entreprise dépasse la simple collecte testimoniale pour interroger les modalités contemporaines du récit de soi et d’autrui. L’auteur développe une écriture de l’urgence qui emprunte ses codes au reportage tout en préservant une densité littéraire indéniable. Cette hybridation stylistique reflète les transformations plus larges de l’écriture contemporaine, où les frontières entre genres s’estompent au profit d’approches transversales. La réussite de La Mola tient à sa capacité à maintenir une exigence littéraire sans sacrifier l’accessibilité du propos, démontrant que l’art de raconter peut servir l’efficacité sociologique sans s’y réduire.
Les questions éthiques soulevées par l’ouvrage résonnent avec les débats contemporains sur les limites de la représentation artistique. L’auteur assume pleinement les risques de son entreprise : voyeurisme potentiel, instrumentalisation du malheur social, esthétisation de la violence. Cette conscience critique traverse l’ensemble du récit, transformant les scrupules de l’auteur en matière narrative et en garantie déontologique. La dimension réflexive de l’écriture permet d’éviter les écueils du sensationnalisme tout en préservant l’impact émotionnel nécessaire à la transmission de l’expérience documentée.
L’apport de cette œuvre au débat public français sur les questions sécuritaires et sociales ne saurait être négligé. En donnant la parole à celui qui est habituellement réduit au silence par la justice et les médias, La Mola contribue à complexifier les représentations dominantes de la délinquance urbaine. Sans verser dans l’angélisme ni dans la diabolisation, il offre des clés de compréhension qui enrichissent la réflexion collective sur l’état de la cohésion sociale française. Cette dimension civique de l’œuvre, jamais explicitement revendiquée mais constamment présente, confère au récit une résonance qui dépasse largement le cercle des amateurs de faits divers pour toucher quiconque s’interroge sur l’évolution de notre société. L’ouvrage s’impose ainsi comme un témoignage capital sur une époque où les fractures sociales redessinent en profondeur la géographie humaine de la République.
Mots-clés : Marseille, Témoignage, Violence urbaine, Quartiers nord, Docu-fiction, Criminalité, Exclusion sociale
Extrait Première Page du livre
» 1
L’idée
Ce matin je tourne en rond dans mon bureau, je cherche à savoir comment je vais m’y prendre, comment je vais appréhender le sujet et surtout comment je vais le lui présenter.
J’enfile un léger blouson de lin et plonge dans l’enfer de la ville, la cagole hurle et pourtant il n’est que huit heures. Un soleil fainéant tente de percer une épaisse et courageuse couche de nuages. Ici tout est contraste …
C’est encore à la Samaritaine que je prends place, sa terrasse est superbe et j’affectionne la vue sur la Vierge de la garde, elle fait ce qu’elle peut pour défendre une ville dévorée par le deal et le sang versé. Elle échoue souvent. Face à elle la mairie centrale baisse les yeux pour ne pas subir les foudres de la vierge et de l’Enfant Jésus.
Le vieux port s’anime, son marché aussi et lentement les rares poissons déjà mis en vente frétillent encore avant d’être occis dans des mains vigoureuses de cuisinières locales et déterminées. Moi je commande un café et patiente avant l’arrivée de mon ami. J’ai travaillé mon texte, j’ai mis des mots précis que je vais lui balancer alors même qu’il posera son séant sur cette chaise encore vide. Je ne dois pas lui laisser la parole, je dois l’inonder avant même qu’il ne réagisse. C’est un homme franc et direct, il ne mettra pas de gants pour me dire non s’il pense que mon idée est grotesque ou même dangereuse. Je dois être convaincant, percutant.
Je sirote mon petit noir en avalant rapidement un petit spéculoos au goût prononcé de cannelle. Je ressasse mes idées, je répète inlassablement mes mots et me surprends même à les réciter à haute et intelligible voix. Je provoque le sourire d’une femme attablée non loin de moi.
L’idée est pourtant simple, elle a germé dans mon crâne quelques mois auparavant où durant l’écriture d’un précédent ouvrage je suis allé à la rencontre de personnes impliquées dans le banditisme Marseillais. J’ai croisé de vrais voyous des quartiers nord, tous ont accepté de me parler de leur expérience et de leurs ambitions mais pas un ne s’est aventuré sur le terrain boueux des règlements de compte. Certes un ou deux se sont vantés d’avoir participé, d’avoir tenu une Kalachnikov meurtrière et d’avoir pressé la détente pour dessouder un rival mais leurs propos restaient sans réponse puisque le but de ce livre n’était pas d’évoquer cela mais surtout parce qu’il n’était pas difficile pour moi de comprendre que j’avais face à moi de vrais mythomanes désireux de se faire « mousser » pour exister autrement qu’à travers leur triste et minable vie. J’ai de multiples fois esquivé, détourné la conversation pour ne pas perdre de vue mon idée première. «
- Titre : Samir tueur des quartiers nord
- Auteur : Marc La Mola
- Éditeur : Sudarenes Editions
- Nationalité : France
- Date de sortie : 2022
Page officielle : lamolagarcia.com
Résumé
Marseille, sa corniche et son littoral. Marseille et ses cités excentrées dans le nord de la ville.
C’est là que j’ai été flic, un flic au milieu d’un océan de barbarie… Les noms de ces quartiers peuvent sembler enchanteurs : le Clos la Rose, les Micocouliers, Frais Vallon… et tant d’autres endroits où les flics et les marins-pompiers ne se rendent plus. Des quartiers à l’abandon dans lesquels ne règnent qu’une loi : celle des caïds et du narcotrafic.
Durant ma carrière, au sein de la Brigade Criminelle de la Police Judiciaire ou à la Brigade de Sûreté Urbaine du secteur Nord, j’ai croisé des centaines de personnes impliquées dans les trafics de drogue, j’ai échangé avec des dealers minables comme j’ai entendu de vrais criminels capables de prendre les armes pour asseoir leur business. Froidement ils me relataient leurs « exploits » sans retenue et sans regrets. Leurs récits me glaçaient le sang. Dans cet ouvrage j’>ai condensé tout ce que j’ai vu et entendu, tout ce que ces dealers sanguinaires m’ont raconté. Un des leurs, Samir, a été plus prolixe que les autres. Par le menu il m’a raconté son ascension dans les trafics de stupéfiants puis comment il a pris les armes, la Kalachnikov, pour aller occire ceux qui furent ses amis devenus des rivaux. Mais Samir existe-t-il vraiment ? A lui seul ce personnage que j’ai créé ou pas, incarne le monstre sommeillant aux pieds de chacun des immeubles de ces cités du nord de Marseille. Mais ce qui m’intéressait dans ce livre n’est pas seulement le récit mais surtout de tenter de comprendre ce qu’il se passe dans la tête de celui que je nomme Samir. Depuis sa plus tendre enfance jusqu’à l’incendie qu’il déclenche pour brûler un homme enfermé dans le coffre d’une voiture Samir m’a raconté son périple criminel.
Dans une étrange mise en scène où se multiplient les têtes à têtes entre Samir et moi je vous raconte ce que j’ai entendu et vu durant plus de trente années de Police dans les quartiers nord de la deuxième ville de France où la came se deale allègrement au nez et à la barbe des autorités. C’est aussi là que les comptes se règlent au son des crépitements des balles de l’AK 47. L’écriture d`un tel récit a été éprouvante…
D’autres chroniques de livres de Marc La Mola

Je m’appelle Manuel et je suis passionné par les polars depuis une soixantaine d’années, une passion qui ne montre aucun signe d’essoufflement.