Une intrigue à double temporalité
Laure Barachin orchestre avec habileté un ballet temporel où se répondent deux époques, deux mystères, deux femmes séparées par plus de vingt ans. L’architecture narrative de « L’été où Mylena a disparu » repose sur cette construction en miroir qui fait dialoguer l’été 1998 et l’année 2022, créant un effet de résonance particulièrement saisissant. Cette structure en diptyque permet à l’auteure d’explorer les ramifications du temps sur la mémoire et la quête de vérité, tout en maintenant un suspense constant qui irrigue l’ensemble du récit.
Le génie de cette construction réside dans la manière dont les deux temporalités s’éclairent mutuellement sans jamais se répéter. La disparition de Mylena en 1998 trouve un écho troublant dans celle de Maryna en 2022, créant un jeu de correspondances qui transcende les décennies. Barachin évite l’écueil de la simple répétition en variant les perspectives narratives et en enrichissant progressivement la compréhension des événements passés à la lumière des découvertes présentes.
Cette dualité temporelle offre également à l’auteure l’opportunité d’explorer l’évolution de ses personnages, particulièrement celle de Stéphanie, qui passe du statut d’adolescente démunie à celui de magistrate accomplie. La transformation du personnage principal s’inscrit dans cette tension entre passé et présent, entre vulnérabilité et force acquise, conférant au roman une profondeur psychologique remarquable.
L’alternance des chapitres entre les deux époques crée un rythme narratif envoûtant, où chaque retour en arrière apporte son lot de révélations tout en soulevant de nouvelles interrogations. Cette mécanique temporelle sophistiquée transforme la lecture en une véritable enquête où le lecteur devient complice de cette archéologie des secrets, fouillant avec les personnages dans les strates du temps pour exhumer la vérité.
livres de Laure Barachin à acheter
Portraits de femmes en quête de vérité
Au cœur du roman de Laure Barachin se dessine une galerie de portraits féminins d’une remarquable diversité, unis par une même soif de justice et de compréhension. Stéphanie, figure centrale de cette constellation, incarne cette détermination farouche qui transforme une adolescente meurtrie en magistrate inflexible. Son parcours dessine l’arc d’une rédemption personnelle où la quête de vérité sur la disparition de Mylena devient indissociable de sa propre reconstruction identitaire. L’auteure évite avec finesse l’écueil du personnage parfait en maintenant chez Stéphanie une vulnérabilité qui la rend profondément humaine.
Olena, mère ukrainienne en exil, apporte une dimension géopolitique contemporaine à cette fresque féminine tout en incarnant la douleur universelle de la perte d’un enfant. Sa recherche désespérée de Maryna résonne avec celle de Stéphanie, créant entre ces deux femmes une solidarité qui transcende les différences culturelles et générationnelles. Barachin saisit avec justesse la complexité de ce personnage pris entre espoir et désespoir, entre rage et résignation, sans jamais verser dans le pathétique.
Katia et Marianne complètent ce quatuor en apportant chacune leur perspective unique sur les relations humaines et les tourments de l’existence. La première, Franco-Russe déchirée par les conflits de son époque, la seconde, professeure d’histoire désabusée mais bienveillante, enrichissent la réflexion sur les liens qui unissent les femmes face à l’adversité. Leur club de lecture devient le symbole de cette sororité intellectuelle et émotionnelle qui permet de supporter l’insupportable.
Cette polyphonie féminine trouve son écho dans les figures du passé, notamment Thérèse, dont le journal intime révèle une autre facette de la condition féminine dans les années cinquante. En tissant ces liens entre les générations, Barachin démontre que la quête de vérité et de justice traverse les époques, portée par des femmes qui refusent le silence et l’oubli. Ces personnages féminins, loin d’être de simples faire-valoir, constituent la véritable force motrice du récit.
La mémoire comme fil conducteur
La mémoire se déploie dans le roman de Laure Barachin comme un labyrinthe aux multiples entrées, où chaque souvenir peut révéler un pan caché de la vérité ou au contraire l’obscurcir davantage. L’auteure explore avec subtilité les méandres de la réminiscence, montrant comment les événements du passé se recomposent sous l’éclairage du présent. Cette approche permet de saisir la complexité des rapports entre mémoire individuelle et collective, entre ce que l’on croit se rappeler et ce qui s’est réellement produit.
Les objets deviennent dans cette perspective de véritables déclencheurs mémoriels : une cassette audio, un livre dédicacé, des aquarelles signées d’un mystérieux « M. Ferrer » fonctionnent comme autant de madeleines proustiennes qui font resurgir des pans entiers du passé. Barachin manie ces éléments matériels avec une précision d’orfèvre, transformant chaque découverte en révélation potentielle. Ces traces tangibles du temps écoulé acquièrent une dimension presque sacrée dans la quête obsessionnelle de vérité menée par les protagonistes.
L’écriture elle-même devient un acte mémoriel fondamental : les carnets de Thérèse, retrouvés après des décennies, témoignent de cette volonté de préserver les souvenirs contre l’effacement du temps. De même, le projet d’écriture de Stéphanie sur « L’été de nos dix-huit ans » s’impose comme une nécessité vitale, une tentative de ressusciter Mylena par les mots. Cette mise en abyme de l’acte créateur révèle la conviction profonde de l’auteure que seule la littérature peut véritablement sauver de l’oubli.
La mémoire collective, incarnée par les témoignages sur la guerre civile espagnole ou les récits ukrainiens contemporains, vient enrichir cette réflexion en montrant comment les traumatismes historiques se transmettent de génération en génération. Barachin démontre avec finesse que les blessures du passé continuent de saigner dans le présent, et que comprendre l’histoire familiale devient indispensable pour déchiffrer les mystères contemporains. Cette dimension historique confère au roman une profondeur qui dépasse largement le cadre du simple polar.
A lire aussi

Les Frissons de l’homme d’Adrien Bellafon : quand le polar rencontre la noirceur de l’âme humaine

Quelques nuances… d’auteur.e.s de polars : rendez-vous à Québec

Chiens fous de Max Monnehay : un avocat face à l’indéfendable

« En attendant le déluge » de Dolores Redondo : une traque de Glasgow à Bilbao
Entre polar contemporain et récit historique
Laure Barachin navigue avec une aisance remarquable entre les codes du roman policier contemporain et ceux du récit historique, créant une œuvre hybride qui transcende les frontières génériques traditionnelles. L’enquête menée par Stéphanie sur la disparition de Mylena épouse parfaitement les attentes du polar moderne : investigations méthodiques, révélations progressives, personnages aux motivations troubles. Pourtant, l’auteure enrichit cette trame policière en l’ancrant dans une réflexion plus vaste sur les traumatismes historiques et leur transmission à travers les générations.
L’intrication des mystères contemporains avec les secrets du passé révèle la maîtrise narrative de Barachin, qui parvient à maintenir l’intensité du suspense tout en déployant une fresque historique ambitieuse. Les événements de la guerre civile espagnole ne constituent pas un simple décor exotique mais s’avèrent intimement liés aux drames du présent. Cette connexion entre les époques dépasse le procédé littéraire pour devenir une véritable philosophie du récit, où l’Histoire avec un grand H éclaire les histoires individuelles.
La documentation historique transparaît sans jamais alourdir le récit, témoignant d’un travail de recherche approfondi que l’auteure intègre avec fluidité dans la narration. Les références à la guerre d’Ukraine, aux camps de réfugiés espagnols ou aux massacres de Babi Yar s’insèrent naturellement dans les préoccupations des personnages, évitant l’écueil de la leçon d’histoire plaquée. Cette approche permet au roman de gagner en épaisseur sans perdre en accessibilité.
L’originalité de cette construction réside dans la capacité de Barachin à faire dialoguer différents types de violence : celle, intime, des disparitions inexpliquées, et celle, collective, des conflits armés et des persécutions. Cette mise en perspective confère au roman une dimension universelle qui dépasse le cadre français pour toucher aux grands enjeux contemporains. Le polar devient ainsi le véhicule d’une réflexion plus large sur la mémoire, la justice et la transmission des traumatismes.
L’amitié féminine au cœur du récit
L’amitié entre Stéphanie et Mylena constitue le socle émotionnel sur lequel repose l’édifice narratif de Laure Barachin. Cette relation fusionnelle, née dans l’adversité d’un foyer pour enfants, transcende les différences de caractère et de destinée pour devenir une véritable sororité de survie. L’auteure évite l’idéalisation en montrant les tensions et les incompréhensions qui traversent cette amitié, notamment face aux choix de vie discutables de Mylena. Cette nuance psychologique enrichit considérablement la crédibilité des personnages et la profondeur émotionnelle du récit.
Le club de lecture « Les Amoureux de la littérature » offre une déclinaison contemporaine de cette thématique, révélant comment l’amitié féminine peut renaître à l’âge adulte autour de passions partagées. Marianne, Katia et Olena gravitent autour de Stéphanie dans une constellation affective qui pallie les absences familiales. Barachin dessine avec justesse ces nouvelles solidarités choisies, montrant comment la littérature devient le ciment de relations profondes entre femmes que tout pourrait séparer : l’origine sociale, la nationalité, l’âge ou les épreuves traversées.
La force de ces liens féminins se révèle particulièrement dans l’épreuve, lorsque la quête de vérité exige courage et persévérance. L’entraide entre ces femmes ne relève jamais de la complaisance mais d’une lucidité partagée face aux difficultés de l’existence. L’auteure saisit avec finesse ces moments où l’amitié devient refuge, ressource et moteur d’action, sans verser dans une vision édulcorée des relations humaines.
Cette célébration de la sororité s’enrichit d’une dimension intergénérationnelle particulièrement réussie, notamment à travers le personnage de Thérèse dont le journal révèle des préoccupations étonnamment modernes. En tissant ces liens entre les femmes d’hier et d’aujourd’hui, Barachin démontre que certaines luttes traversent les époques et que l’amitié féminine constitue un rempart intemporel contre l’isolement et l’injustice. Cette vision optimiste, sans naïveté, confère au roman une dimension humaniste particulièrement touchante.
Les meilleurs livres à acheter
Géographie littéraire : de l’Occitanie à la Bretagne
L’espace géographique déploie dans le roman de Laure Barachin une cartographie symbolique où chaque lieu porte en lui une charge émotionnelle et narrative spécifique. De Montauban à Perros-Guirec, en passant par les côtes espagnoles de Peñíscola, l’auteure dessine un parcours initiatique qui épouse les méandres de l’enquête et de la mémoire. Cette géographie n’est jamais gratuite : elle accompagne et révèle l’évolution psychologique des personnages, transformant chaque déplacement en étape significative de leur quête personnelle.
La Bretagne occupe une position particulière dans cette cartographie romanesque, incarnant à la fois l’aboutissement de la recherche et l’espoir d’une révélation finale. Les paysages côtiers, avec leurs phares et leurs rochers de granit rose, offrent un décor à la fois grandiose et mélancolique qui sied parfaitement à l’atmosphère du dénouement. Barachin exploite avec habileté la dimension mystérieuse de cette région, terre de légendes et de secrets, pour créer un cadre propice aux révélations ultimes.
L’Espagne, évoquée à travers les souvenirs de Larraga et de Peñíscola, introduit une dimension historique cruciale qui enrichit la compréhension des enjeux contemporains. Ces terres ibériques portent les cicatrices de la guerre civile et deviennent le théâtre d’une transmission traumatique entre générations. L’auteure évite l’exotisme facile pour ancrer solidement ses personnages dans une réalité géographique et historique précise, conférant à son récit une crédibilité documentaire appréciable.
Cette circulation géographique reflète également la mobilité contemporaine des personnages, magistrate, militaire, universitaire, qui traversent la France au gré de leurs affectations et de leurs recherches. Barachin saisit avec justesse cette France des déplacements professionnels et personnels, où les attaches territoriales se recomposent sans cesse. Cette modernité géographique ancre fermement le roman dans son époque tout en révélant comment certains lieux deviennent des refuges de mémoire dans un monde en perpétuel mouvement.
La littérature comme refuge et révélation
Les références littéraires tissent dans le roman de Laure Barachin un réseau dense de significations qui transforment chaque citation en indice potentiel, chaque livre en témoin silencieux du passé. L’exemplaire de « La Chute » d’Albert Camus, annoté et souligné par Stéphanie et Mylena durant leurs années de lycée, devient bien plus qu’un simple souvenir scolaire : il incarne la permanence des questionnements moraux face à l’adversité. Cette présence constante de la littérature dans la vie des personnages révèle la conviction profonde de l’auteure que les livres constituent des refuges essentiels contre la brutalité du monde.
Le club de lecture « Les Amoureux de la littérature » matérialise cette fonction salvatrice des œuvres littéraires en créant un espace de partage et de réconfort entre femmes meurtries par l’existence. Barachin évite l’écueil de l’intellectualisme en montrant comment Dostoïevski, Tolstoï ou Boulgakov parlent directement aux préoccupations contemporaines de ses personnages. Cette démocratisation de la culture savante s’opère naturellement, sans condescendance, révélant la capacité de l’auteure à rendre accessible un patrimoine littéraire exigeant.
L’écriture elle-même devient un acte de résistance et de mémoire lorsque Stéphanie entreprend la rédaction de « L’été de nos dix-huit ans ». Cette mise en abyme révèle la dimension thérapeutique de la création littéraire, capable de donner forme au chaos des souvenirs et de transformer la douleur en beauté. L’auteure explore avec finesse cette alchimie mystérieuse qui permet aux mots de ressusciter les disparus et de panser les blessures du temps.
Les carnets de Thérèse illustrent parfaitement cette dimension révélatrice de l’écriture, ces pages jaunies devenant les clés d’un mystère vieux de plusieurs décennies. Barachin démontre ainsi que la littérature, sous toutes ses formes, constitue un moyen privilégié de transmission et de préservation de la vérité. Cette foi en la puissance des mots confère au roman une dimension métalittéraire particulièrement réussie, où l’acte d’écrire devient indissociable de la quête de justice et de vérité qui anime l’ensemble du récit.
Les meilleurs livres à acheter
Un roman de la résilience et de la justice
Laure Barachin signe avec « L’été où Mylena a disparu » une œuvre profondément humaniste qui transcende les codes du genre policier pour devenir un véritable hymne à la résilience humaine. L’auteure démontre avec une force particulière comment les épreuves les plus douloureuses peuvent paradoxalement révéler les ressources insoupçonnées des individus. Le parcours de Stéphanie, de l’adolescente abandonnée à la magistrate accomplie, illustre cette capacité de transformation qui refuse la fatalité sociale et personnelle. Cette vision optimiste, sans naïveté, confère au roman une dimension universelle qui dépasse largement le cadre de l’intrigue policière.
La quête de justice qui anime les personnages principaux ne se limite pas à l’élucidation des mystères contemporains mais embrasse une conception plus large de la réparation des torts du passé. Stéphanie ne cherche pas seulement à comprendre ce qui est arrivé à Mylena ; elle aspire à rendre justice à toutes les victimes oubliées, de Thérèse assassinée dans les années cinquante aux jeunes femmes exploitées par les réseaux de traite humaine. Cette amplification progressive des enjeux révèle l’ambition morale de l’auteure, qui refuse de cantonner son récit à un simple fait divers.
L’œuvre explore également les mécanismes complexes de la reconstruction après le trauma, montrant comment la solidarité féminine et l’engagement professionnel peuvent devenir des moyens de sublimation de la souffrance personnelle. Barachin évite l’écueil du misérabilisme en montrant ses personnages dans leur capacité d’action et de dépassement, sans pour autant nier la persistance des blessures. Cette approche nuancée de la psychologie humaine confère au roman une crédibilité émotionnelle remarquable.
Le dénouement, sans révéler ses secrets, confirme cette philosophie de l’action contre l’oubli et l’impunité. L’auteure parvient à clore son récit sur une note d’espoir tempéré qui respecte la complexité des situations évoquées tout en affirmant la possibilité d’un sens, d’une vérité accessible malgré les zones d’ombre irréductibles. Cette sagesse narrative, qui accepte l’incomplétude tout en célébrant la persévérance humaine, constitue sans doute l’une des plus belles réussites de ce roman attachant et profondément généreux.
Mots-clés : Polar contemporain, Double temporalité, Amitié féminine, Mémoire collective, Justice sociale, Résilience, Littérature refuge
Extrait Première Page du livre
» La fin de l’été
Septembre 1998.
« Nous n’avons pas d’avenir si nous restons ici. »
Mylena venait d’ouvrir la fenêtre et ses beaux yeux bleus regardaient le ciel comme si elle espérait s’envoler, tel un oiseau prêt à retrouver sa liberté. Le vent de l’orage qui se profilait à l’horizon, en cette fin d’été, faisait flotter ses longs cheveux bruns. D’inquiétants nuages noirs commençaient à se former.
« Je veux devenir magistrate, ajouta-t-elle. Il m’a promis qu’il m’aiderait, que l’argent ne serait plus un problème. Après cette soirée, j’aurai tout ce qu’il faut pour payer nos études de Droit, le loyer de notre appartement, et même nos loisirs, cerise sur le gâteau ! Nous reviendrons en Ariège pendant les vacances, pour aller skier ! »
Elle avait un air mutin puis elle précisa sa pensée.
« Je n’oublie pas tes livres, ma sœur, tu pourras aller aussi au cinéma voir tes films d’intello et au théâtre, pourquoi pas ? Si l’envie t’en prend. Ou à l’opéra ! »
Elle se mit à rire et tourna le dos à la fenêtre pour regarder Stéphanie, assise sur le lit de la chambre qu’elles partageaient depuis cinq ans, dans cette Maison d’enfants à caractère social de Pamiers. Mylena tenait sa cigarette entre l’index et le majeur avec un air de femme distinguée et émancipée. Elle venait d’avoir dix-huit ans.
« Si tu n’as pas trop honte de moi et de mes activités secrètes, je serai ravie de t’accompagner. Moi aussi, j’adore me cultiver et une bonne accompagnatrice doit avoir de la conversation. »
Stéphanie songeait à ce mot « accompagnatrice », à la réalité sordide qu’il pouvait parfois dissimuler et à sa mère qui ne donnait pas signe de vie. Mylena n’était pas sa sœur mais Stéphanie aimait la façon affectueuse et complice qu’elle avait de répéter ce « ma sœur » comme un leitmotiv qui les protégeait de la solitude et de la violence. «
- Titre : L’été où Mylena a disparu
- Auteur : Laure Barachin
- Éditeur : Auto-édition
- Nationalité : France
- Date de sortie : 2024
Résumé
De l’Occitanie à la Bretagne, de la France à l’Espagne, de Kiev à Montauban et Toulouse, « L’été où Mylena a disparu » est la quête de quatre amies pour retrouver deux jeunes filles…
Été 1998, Mylena et Stéphanie sont deux amies d’enfance inséparables. À la fin des vacances, Mylena disparaît. Elle avait dix-huit ans et rêvait de devenir avocate, magistrate ou chanteuse.
Avril 2022, Stéphanie a réalisé les ambitions de son amie et est devenue magistrate. Olena, professeur d’Histoire à Kiev, cherche sa fille Maryna. Elle se réfugie à Montauban où son amie Marianne l’héberge et la présente à Stéphanie. Avec Katia, une scénariste franco-russe, elles vont former le groupe de lecture « Les Amoureux de la littérature ».
La disparition de Maryna fait resurgir le souvenir de Mylena. Qu’est-il arrivé à ces deux jeunes filles? Et si le passé permettait d’expliquer le présent? Et si le présent permettait de comprendre les mystères du passé?
« L’été où Mylena a disparu » est un roman contemporain sur l’amour maternel et filial mais aussi la guerre et la paix.

Je m’appelle Manuel et je suis passionné par les polars depuis une soixantaine d’années, une passion qui ne montre aucun signe d’essoufflement.


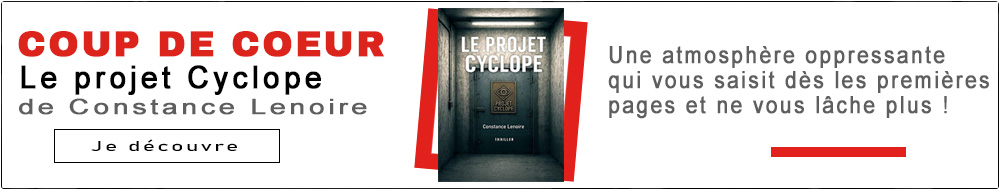


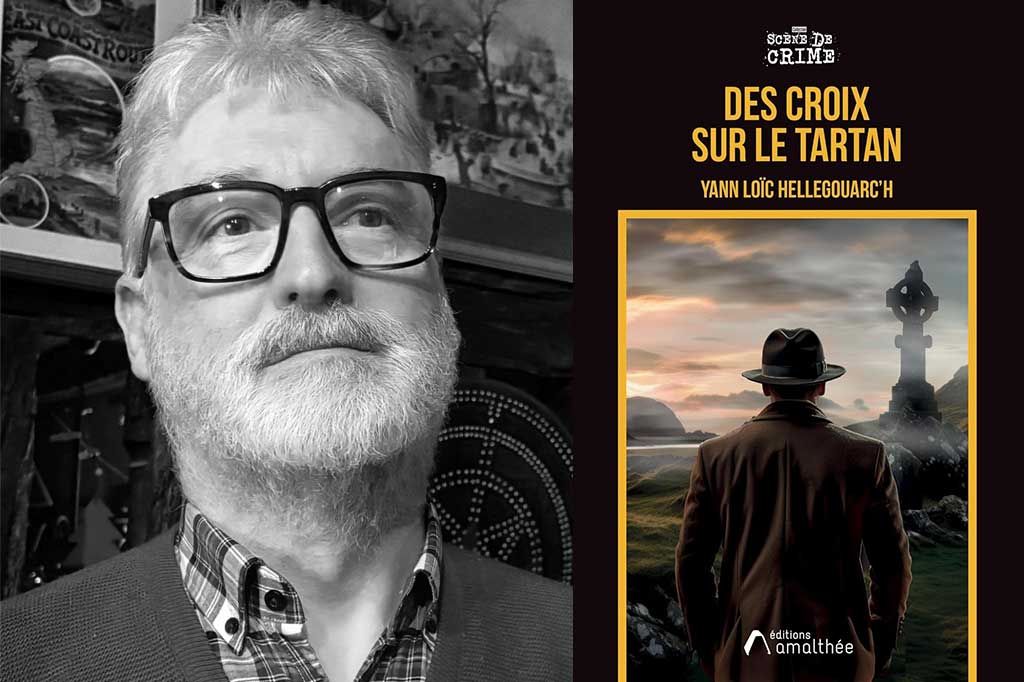
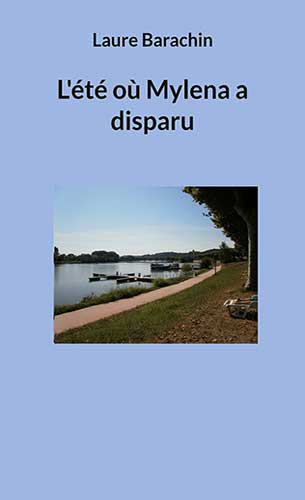
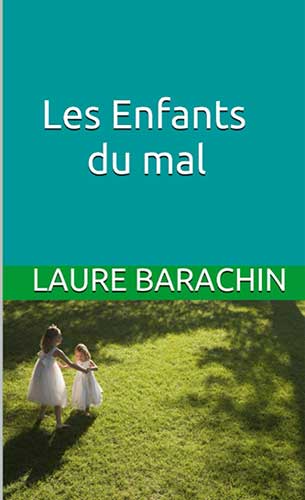
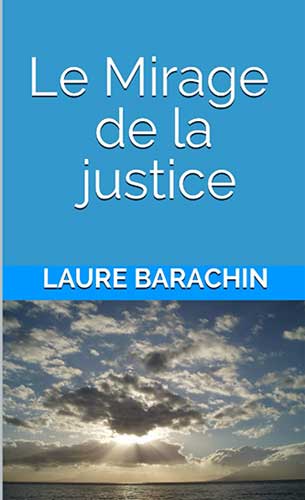













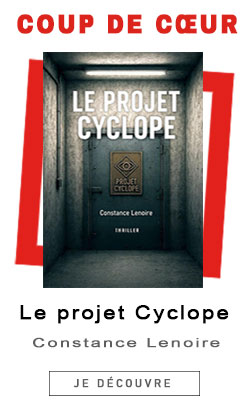
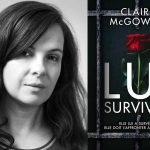

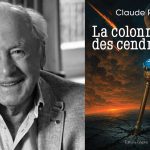
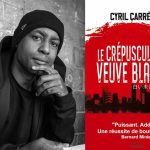
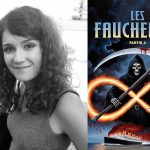
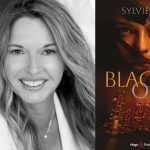


Merci pour cette superbe chronique qui rend bien compte de tous les aspects du roman!