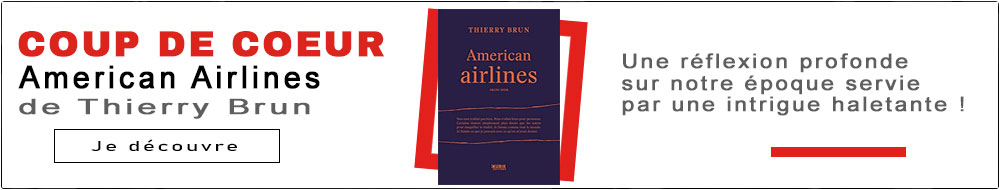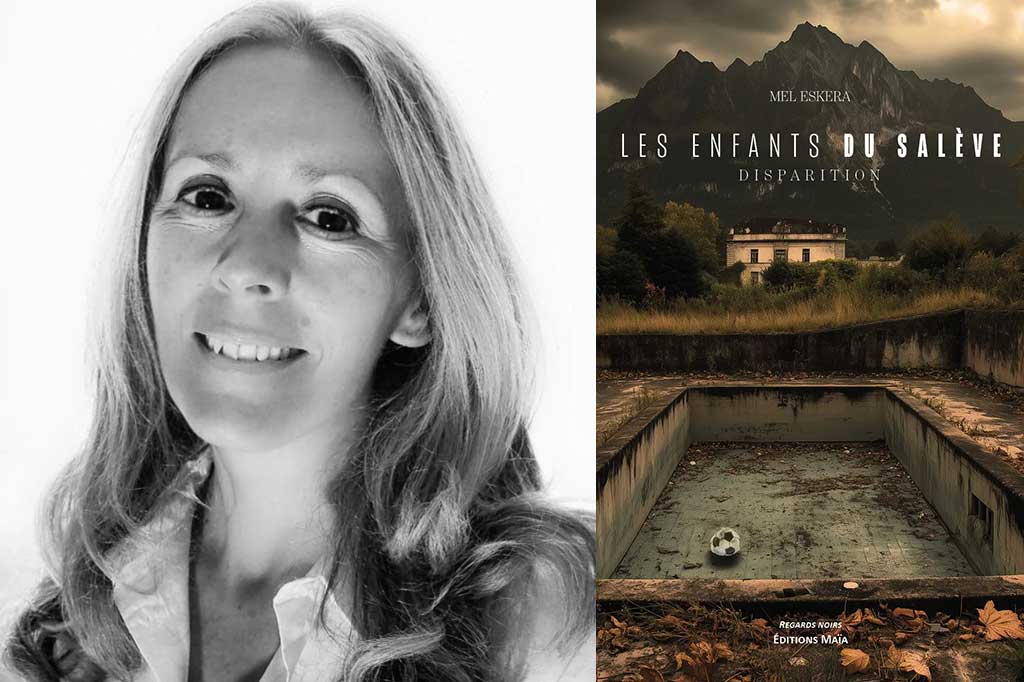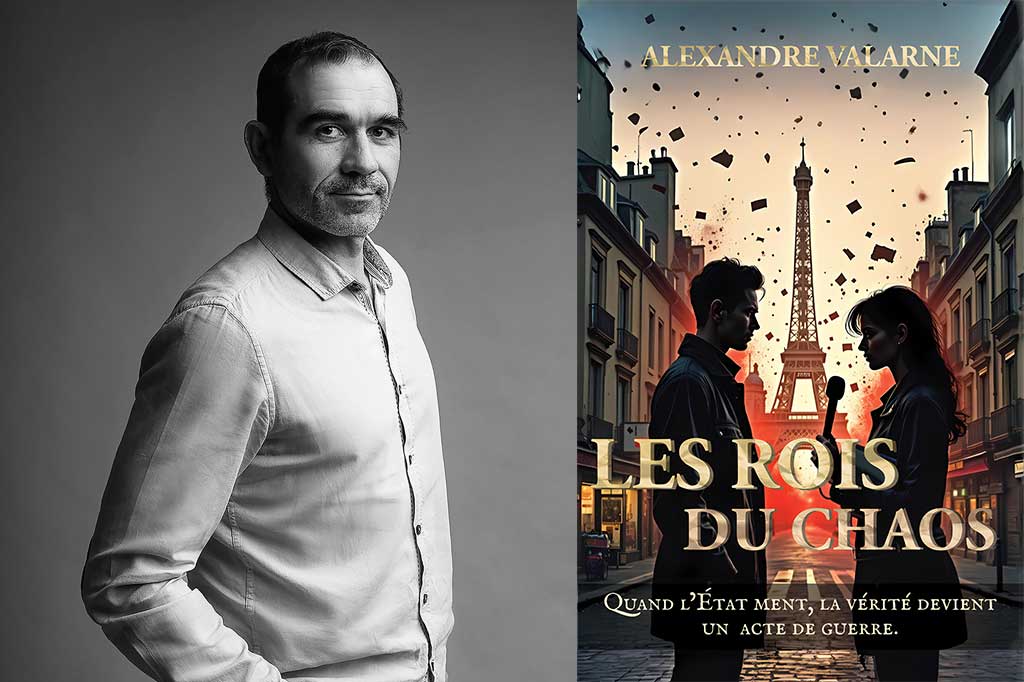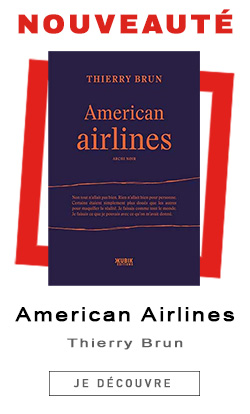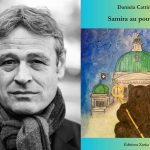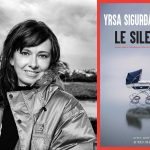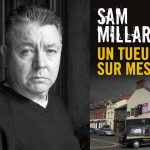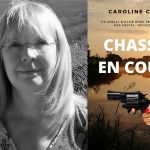Une voix narrative au cœur des ténèbres
Vanessa Trüb fait le choix audacieux d’une narration italique pour restituer la conscience d’une enfant prise au piège de l’horreur quotidienne. Cette voix intérieure, marquée typographiquement, crée une distance formelle qui paradoxalement rapproche le lecteur de l’intimité déchirée du personnage. L’auteure parvient à maintenir cette perspective enfantine sans jamais sombrer dans le pathos ou la complaisance, offrant une fenêtre sur un univers où la violence s’est normalisée au point de devenir le langage même de l’existence. Le contraste entre l’innocence du regard et la brutalité des faits observés génère une tension narrative qui traverse l’ensemble du roman comme un fil électrique à vif.
La construction temporelle du récit repose sur un va-et-vient maîtrisé entre les années 1970 et l’enquête contemporaine menée par Nathan et son équipe. Cette alternance permet d’entrelacer deux registres distincts : l’univers rural oppressant de Longirod où se déploie le trauma originel, et le monde policier méthodique qui tente, des décennies plus tard, d’en déchiffrer les conséquences. Trüb évite l’écueil du suspense artificiel en révélant progressivement les connexions entre passé et présent, laissant au lecteur le soin d’assembler lui-même les fragments d’une vérité enfouie. Les chapitres numérotés scandent cette progression avec une régularité qui évoque autant le rythme d’une investigation que celui d’une descente aux enfers mémorielle.
L’écriture de Vanessa Trüb témoigne d’une compréhension fine des mécanismes de la mémoire traumatique. Les scènes de l’enfance surgissent avec une précision sensorielle remarquable – le froid du pied mouillé, l’odeur du poulailler, la douleur physique décrite sans détours – créant une authenticité qui ne doit rien à la complaisance descriptive. L’auteure sait doser l’explicite et le suggéré, permettant au lecteur de mesurer l’ampleur des abus sans jamais transformer son texte en catalogue de l’horreur. Cette retenue formelle, loin d’atténuer l’impact du récit, en démultiplie au contraire la puissance émotionnelle.
Le Livre de Vanessa Trüb à découvrir
L’architecture narrative entre passé et présent
Le roman déploie une structure double qui fonctionne comme un système de miroirs déformants. D’un côté, les chapitres plongent dans l’univers claustrophobique de novembre 1973, où une enfant assiste à l’enterrement de son oncle avec un mélange de soulagement et de terreur anticipée. De l’autre, l’enquête policière contemporaine progresse méthodiquement, tissant des liens entre des morts apparemment accidentelles échelonnées sur plusieurs décennies. Trüb orchestre ces deux temporalités sans jamais céder à la facilité du parallélisme systématique, préférant laisser les échos se propager naturellement entre les époques, comme des ondes longues qui finissent toujours par atteindre la rive.
La romancière démontre une habileté certaine dans le maniement des codes du polar tout en les subordonnant à une interrogation plus vaste sur la transmission du trauma. Nathan, Jacques et Ajda ne sont pas de simples enquêteurs fonctionnels : ils incarnent une société qui commence enfin à regarder en face ce qu’elle a longtemps préféré ignorer. Leurs investigations recoupent des témoignages, exploitent la technologie moderne, confrontent les silences institutionnels, reconstituant ainsi patiemment une vérité que les conventions sociales et familiales avaient murée. La filature du trio de dealers à Genève, les échanges avec le commandant Steintz, les interrogatoires successifs composent une mosaïque où chaque pièce fait progresser simultanément l’intrigue policière et la compréhension psychologique des personnages.
Ce qui frappe particulièrement dans cette construction, c’est la manière dont Trüb parvient à maintenir deux rythmes narratifs distincts sans que l’un n’écrase l’autre. Les scènes de l’enfance possèdent une densité émotionnelle qui contraste avec le tempo plus analytique de l’enquête, créant une respiration nécessaire dans un récit qui pourrait autrement étouffer sous le poids de son sujet. L’auteure sait ménager des moments de tension différente : l’attente glaçante dans la voiture de surveillance, l’angoisse sourde d’un repas familial en 1973, la découverte progressive d’un arbre généalogique marqué par la mort. Cette polyphonie temporelle transforme le roman en une méditation sur la persistence du mal et sur la possibilité, même tardive, d’une forme de justice.
Les lieux comme mémoire : géographie de la violence
Le village vaudois de Longirod se métamorphose sous la plume de Vanessa Trüb : le village vaudois se métamorphose en territoire mental où chaque lieu porte la marque indélébile de la violence. Le poulailler avec son odeur pestilentielle, la cabane à outils aux portes mal fermées, la grange où se tendent les pièges à rats, le cimetière où se lisent les dates inscrites sur les tombes familiales – tous ces espaces s’imprègnent d’une charge symbolique qui en fait des lieux de mémoire traumatique. L’auteure comprend que le trauma ne se loge pas seulement dans les corps mais qu’il contamine également les géographies, transformant les espaces quotidiens en cartes mentales de la souffrance. La ferme familiale fonctionne ainsi comme un huis clos oppressant où l’enfant ne trouve aucun refuge, où même les animaux qu’elle caresse deviennent des témoins muets de son calvaire.
Cette topographie de l’enfermement trouve son contrepoint dans les déplacements de l’enquête contemporaine. Nathan et son équipe sillonnent la région lémanique, de Gland à Genève en passant par Allaman et Gimel, traçant des itinéraires qui relient géographiquement des événements séparés par des décennies. La filature dans le Léman Express, les parkings souterrains de la gare, les bureaux de la police cantonale composent un paysage urbain contemporain qui s’oppose au monde rural figé des années 1970. Trüb joue subtilement de ce contraste entre deux Suisses : celle, archaïque et patriarcale, des fermes isolées où règne la loi du silence, et celle, moderne et connectée, des caméras de surveillance et des téléphones portables. Cette tension géographique reflète également une tension temporelle, comme si les lieux eux-mêmes portaient la trace des mutations sociales.
Le lac Léman lui-même acquiert une dimension particulière dans cette cartographie romanesque. Lieu de mort apparemment accidentelle pour Jean Dutroit en 1993, il incarne cette capacité des eaux profondes à engloutir les secrets tout en les préservant. L’album de famille que consulte Nathan, les photos de mariage austères, les visages qui ne sourient jamais constituent une autre forme de géographie intime, celle des lignées familiales où se transmettent aussi bien les traits physiques que les blessures psychiques. Vanessa Trüb dessine ainsi une cartographie à plusieurs strates où se superposent les lieux physiques, les espaces mentaux et les territoires affectifs.
Les meilleurs polars à dévorer chez amazon
Les mécanismes du silence et de la mémoire
Le roman explore avec une acuité remarquable comment le silence devient le véritable ciment des structures familiales et sociales fondées sur l’abus. Serge, le frère de l’enfant narratrice, « ne parlait jamais » selon les mots répétés du père qui le traite de débile, alors même qu’il crée des objets délicats en bois. Cette absence de parole ne relève pas d’une incapacité cognitive mais d’une stratégie de survie face à l’indicible. Trüb saisit comment les victimes développent des langages alternatifs – les larmes de Serge dans sa cachette, les regards échangés lors de l’enterrement, la vigilance constante de l’enfant qui surveille les expressions faciales de son père pour anticiper les violences à venir. Le mutisme se révèle ainsi comme une forme de résistance paradoxale, un refus de donner des mots à ce qui ne devrait pas exister.
Ce pacte tacite dépasse le cercle familial pour contaminer l’ensemble de la communauté. La mère tousse discrètement derrière sa main gantée, le pasteur prononce des formules creuses sur « l’accident terrible », la tante Ruth siffle ses sous-entendus sans jamais formuler clairement ce qu’elle sait. Même le commandant Steintz, trente ans plus tard, a choisi de classer un dossier suspect pour protéger la réputation de deux familles et épargner à son propre fils la révélation publique de sa relation avec Jean Dutroit. L’auteure montre comment ces silences individuels s’agrègent pour former une chape collective, une omerta qui traverse les décennies et les générations. Les institutions elles-mêmes – l’Église, la police, la famille – deviennent complices par leur refus de nommer, de voir, d’intervenir.
La mémoire fonctionne dans le récit comme une force souterraine qui finit toujours par resurgir malgré les tentatives d’ensevelissement. L’enfant qui compte les dates sur les pierres tombales, qui remarque le prénom de Lison gravé en petit, qui se demande si elle aussi aura un jour deux dates inscrites quelque part, comprend instinctivement que la mémoire laisse des traces matérielles. L’enquête de Nathan repose précisément sur cette conviction que rien ne s’efface totalement : les rapports d’autopsie conservés, les albums photographiques, les livrets de famille deviennent autant de preuves que le passé refuse de se dissoudre complètement. Vanessa Trüb construit ainsi une réflexion sur la mémoire non pas comme simple conservation du passé, mais comme exigence éthique qui finit par rattraper ceux qui ont cru pouvoir enterrer la vérité aussi profondément que les morts au cimetière de Longirod.
Une enquête entre polar et psychologie
Vanessa Trüb emprunte au roman policier ses ressorts les plus efficaces tout en les détournant vers une exploration psychologique approfondie. Nathan et son équipe mobilisent l’arsenal classique de l’investigation moderne : surveillance électronique, filatures minutieuses, analyse de vidéos d’enterrement, recoupement de témoignages contradictoires. La traque du trio de dealers à travers les gares lémaniques, avec ses téléphones jetables et ses fausses pistes, offre des passages d’une tension palpable où le lecteur suit en temps réel les manœuvres et contre-manœuvres. Pourtant, cette dimension policière sert un projet plus ambitieux que la simple résolution d’une énigme criminelle. L’auteure utilise la mécanique de l’enquête comme un instrument pour exhumer des vérités enfouies dans les strates du temps et de la psyché collective.
L’intervention du profileur Thierry marque un basculement significatif dans la compréhension de l’affaire. Son analyse méthodique des meurtres déguisés en accidents, sa lecture de la symbolique du cœur remplacé par une pierre, sa capacité à dresser le portrait psychologique d’une meurtrière façonnée par les abus répétés de l’enfance transforment l’investigation en autopsie d’un trauma générationnel. Trüb évite l’écueil du jargon pseudo-scientifique en intégrant naturellement ces éléments psychologiques dans le dialogue entre enquêteurs, créant ainsi une forme hybride où le polar classique rencontre le roman de filiation et le récit traumatique. Les conversations téléphoniques entre Nathan et Thierry fonctionnent comme des moments de clarification où le puzzle se reconstitue non seulement factuellement mais aussi émotionnellement.
Cette double dimension permet à l’auteure d’interroger la notion même de justice. Que signifie résoudre une affaire quand les crimes originels – les viols d’enfants, la violence domestique, le silence institutionnel – n’ont jamais été reconnus ni sanctionnés ? Nathan et son équipe ne traquent pas simplement une coupable, ils tentent de reconstituer une chaîne causale où victimes et bourreaux s’entremêlent dans une tragédie familiale qui s’étend sur plusieurs décennies. La découverte progressive que l’assassin pourrait être une femme de la fin cinquantaine, « bloquée dans ce projet de destruction de la branche aînée », bouleverse les attentes du genre policier tout en révélant la logique implacable d’une vengeance différée. Trüb parvient ainsi à maintenir le suspense narratif propre au polar tout en creusant des questions éthiques et psychologiques qui dépassent largement le cadre de l’intrigue criminelle.
Les meilleurs polars à dévorer chez amazon
La symbolique du corps et de la pierre
Le titre même du roman annonce une dialectique fondamentale qui traverse l’ensemble du récit. La pierre s’impose d’emblée comme symbole ambivalent : elle marque les tombes au cimetière de Longirod, elle remplace le cœur des victimes dans une mise en scène macabre, elle devient métaphore de la pétrification émotionnelle. Vanessa Trüb tisse un réseau de correspondances où la pierre incarne tour à tour le poids du silence, la dureté nécessaire à la survie et la transformation mortifère de ce qui devrait rester vivant. L’enfant narratrice évoque « les pierres » que son père met dans sa soupe comme « le poids du péché« , matérialisant ainsi une culpabilité imposée qui s’insinue jusque dans l’acte de se nourrir. Cette image saisissante condense la manière dont l’abus transforme les victimes en réceptacles de la faute de leurs bourreaux.
Le corps, quant à lui, occupe une place centrale dans l’économie narrative du roman. Corps violentés, corps meurtris, corps d’enfants dont l’intégrité est systématiquement bafouée – l’auteure n’esquive jamais la dimension physique du trauma. Les souliers vernis trop petits qui font mal, la chaussette mouillée, le pied froid, la douleur de la ceinture sur le dos : ces sensations corporelles précises ancrent le récit dans une réalité tangible qui refuse l’abstraction. Trüb démontre une compréhension fine de la manière dont le trauma s’inscrit dans la chair, comment il colonise les perceptions sensorielles au point que certaines odeurs – celle du poulailler – deviennent indissociables de la violence subie. Le corps devient ainsi un lieu de mémoire involontaire, un palimpseste où se superposent les couches successives de souffrance.
La substitution du cœur par une pierre dans les meurtres contemporains apparaît alors comme l’aboutissement logique de cette symbolique. Ce geste rituel traduit une volonté de signifier que certains êtres ont transformé leurs victimes en statues de sel, qu’ils ont littéralement pétrifié ce qui en elles aurait dû rester fluide et vivant. L’opposition entre pierre et chair cesse d’être une simple métaphore pour devenir le diagnostic d’une pathologie collective, celle d’une société capable de s’endurcir face à la souffrance des plus vulnérables. En choisissant ce titre, Vanessa Trüb ne propose pas seulement une formule évocatrice mais énonce un programme littéraire : explorer comment la violence transforme les vivants en monuments funéraires ambulants, et comment certains finissent par retourner cette pétrification contre ceux qui l’ont infligée.
Le traitement littéraire de la violence
Vanessa Trüb affronte l’un des défis les plus délicats de l’écriture contemporaine : comment représenter la violence extrême sans verser dans le sensationnalisme ni dans l’euphémisation paralysante. Son approche repose sur un équilibre subtil entre nomination directe et ellipse calculée. Lorsque l’enfant narratrice évoque « son machin » pour désigner l’organe de l’agresseur, elle n’use pas d’un vocabulaire cru mais adopte le langage d’une conscience enfantine qui refuse de nommer précisément ce qu’elle subit. Cette distanciation lexicale crée paradoxalement une proximité émotionnelle plus forte que ne le ferait une description clinique. L’auteure sait que certaines violences gagnent en puissance littéraire lorsqu’elles demeurent partiellement dans l’ombre, laissant au lecteur le soin de mesurer l’horreur à partir des indices dispersés dans le texte.
La violence physique – les coups de ceinture qui se sont intensifiés, le dos douloureux après une nuit dans le poulailler, la suffocation lors des agressions – s’inscrit dans une violence symbolique plus vaste qui englobe l’ensemble de l’univers familial. Le père qui traite sa fille de « petite vicieuse », qui l’oblige à « se repentir », qui inverse la culpabilité pour la faire porter par celle qui la subit, incarne cette dimension psychologique de l’abus tout aussi destructrice que les sévices corporels. Trüb comprend que la violence ne se limite pas aux actes mais contamine le langage, les regards, les silences, transformant chaque interaction quotidienne en potentielle menace. Cette omniprésence de la violence latente confère au récit une tension permanente où même les moments de répit apparent demeurent chargés d’une anxiété sourde.
L’écriture assume également sa dimension politique en révélant les structures institutionnelles et religieuses qui permettent la perpétuation des abus. Le cantique entonné lors de l’enterrement – « Dans toutes nos détresses, Dieu nous protégera » – résonne avec une ironie glaçante dans la conscience de l’enfant qui « ne croyait plus en Dieu ». Cette juxtaposition entre le discours religieux consolateur et la réalité des souffrances ignorées expose la faillite morale d’une communauté entière. Vanessa Trüb refuse le confort d’une violence individualisée et montre comment les systèmes familiaux, paroissiaux et judiciaires collaborent activement, par leur inaction, à maintenir l’impunité des prédateurs. Son roman devient ainsi un acte d’accusation littéraire qui désigne non seulement les bourreaux directs mais l’ensemble d’un édifice social construit sur le déni et l’abandon des plus vulnérables.
Les meilleurs polars à dévorer chez amazon
Une œuvre sur la résilience et la vérité
Le roman de Vanessa Trüb s’achève non pas sur une résolution simpliste mais sur l’affirmation que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, demeure préférable au mensonge consolateur. L’enquête menée par Nathan et son équipe ne vise pas uniquement à identifier un coupable mais à restituer une cohérence narrative aux existences brisées, à donner un sens aux morts suspectes qui ont jalonné plusieurs décennies. Cette quête de vérité s’oppose frontalement aux choix du commandant Steintz qui, trente ans auparavant, avait préféré classer l’affaire Jean Dutroit pour éviter de « salir » les réputations familiales. L’auteure suggère ainsi que la résilience authentique ne peut s’édifier sur le déni mais nécessite au contraire une confrontation lucide avec les faits, aussi dérangeants soient-ils pour l’ordre social établi.
La notion de résilience traverse le récit sous des formes multiples et parfois contradictoires. L’enfant qui développe des stratégies de survie – respirer fort par le nez, surveiller les expressions faciales, ne rien montrer – fait preuve d’une capacité d’adaptation remarquable dans un environnement hostile. Pourtant, Trüb se garde bien de romantiser cette résistance enfantine ou d’en faire le terreau d’une quelconque rédemption facile. Le roman reconnaît que certaines blessures ne se referment jamais complètement, que le trauma laisse des cicatrices indélébiles dans la psyché. L’œuvre pose ainsi une question dérangeante : jusqu’où peut-on parler de résilience quand celle-ci se transforme en compulsion destructrice?
« De pierre et de chair » s’inscrit finalement dans une lignée d’œuvres contemporaines qui refusent de détourner le regard face aux zones d’ombre de notre histoire collective. En choisissant de situer son intrigue dans la Suisse rurale des années 1970, Vanessa Trüb éclaire une époque et un milieu où la loi du silence régnait en maître absolu. Son roman fonctionne comme un acte de mémoire nécessaire, une excavation littéraire qui exhume ce que les conventions sociales avaient soigneusement enterré. L’auteure démontre que la littérature possède ce pouvoir unique de dire ce que les institutions ont tu, de nommer ce que la bienséance a préféré taire. En refermant ce livre exigeant, le lecteur emporte avec lui non pas des réponses définitives mais une conscience aiguisée des mécanismes par lesquels les sociétés produisent leurs victimes puis organisent l’oubli de leurs souffrances.
Mots-clés : Trauma familial, Enquête policière, Violence enfantine, Mémoire et silence, Polar psychologique, Suisse rurale, Justice et vérité
Extrait Première Page du livre
» CHAPITRE 1
Longirod, novembre 1973
Elle regardait ses souliers vernis. Ils lui faisaient mal, trop petits. Celui du pied droit avait un trou à l’avant, à la jonction de la semelle et du cuir. La mère lui avait dit de faire attention en marchant. De ne pas trop lever le pied. Pour pas qu’on le voie. Aussi elle avait la chaussette mouillée et le pied tout froid.
Elle avait hâte que le pasteur ait fini de parler pour rentrer mettre ses galoches.
Elle jeta un œil sur l’assistance autour de la tombe ouverte. La famille, quelques paroissiens à cause du père, pas d’amis. Personne ne pleurait.
Les mains de Serge tremblaient un peu. Son visage semblait plus calme. Moins de tics. Tu m’étonnes !
Le porc, son oncle, enfermé dans sa boîte en bois, allait descendre bien profond dans la terre.
Un sentiment mauvais s’insinua dans son cœur. Elle était contente. Contente qu’il soit crevé comme le rat retrouvé ce matin dans un des pièges de la grange. Oui, c’était ça. Contente. De toute façon le père lui disait assez qu’elle était mauvaise, une petite vicieuse.
Elle faisait attention à ne rien montrer. Elle avait remarqué depuis un bon moment que le père la regardait.
Des petits coups d’œil furtifs et à chaque fois lourds d’animosité. Ça n’allait pas être commode ce soir.
Il faudra quand même bien qu’elle mange la soupe, qu’elle avale les pierres qu’il met dedans, « le poids du péché » qu’il disait. Pas envie d’aller dormir dans le poulail-ler. Pas envie d’avoir le dos qui fait mal le lendemain.
Les coups de ceinture étaient devenus si forts depuis deux mois. Et ça, c’était depuis qu’il les avait vus. «
- Titre : De pierre et de chair
- Auteur : Vanessa Trüb
- Éditeur : Éditions Favre SA
- Nationalité : Suisse
- Date de sortie : 2025
Résumé
Le cœur de la victime a été remplacé par une pierre. Pulsion sadique, règlement de comptes entre gangs de motards, vengeance familiale ? Le corps de la jeune fille a été retrouvé au bord d’une route, un petit matin d’hiver. Son assassinat bouleverse toute une communauté.
Une intrigue intense qui interroge sur les différentes visions du pardon et de l’absolution.
Le cœur de la victime a été remplacé par une pierre. Pulsion sadique,…
Le corps de la jeune fille a été retrouvé au bord d’une route, un petit matin d’hiver. Son assassinat bouleverse toute une communauté.
L’inspecteur Nathan Redlink et son équipe mènent l’enquête sur plusieurs fronts. Les mémoires torturées émergent difficilement parmi les habitants de ces petits villages paysans, tant les tabous et les secrets sont pesants. Une violence sourde sévit, celle qui tait les injustices et abîme les âmes.
Les policiers vont devoir se confronter à leurs propres démons et oser d’affranchir des convenances pour percer à jour le mystère d’une malédiction dont la responsabilité incombe à ceux que l’on n’ose que trop rarement soupçonner.

Je m’appelle Manuel et je suis passionné par les polars depuis une soixantaine d’années, une passion qui ne montre aucun signe d’essoufflement.