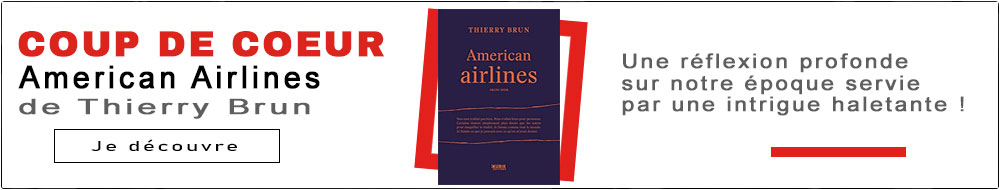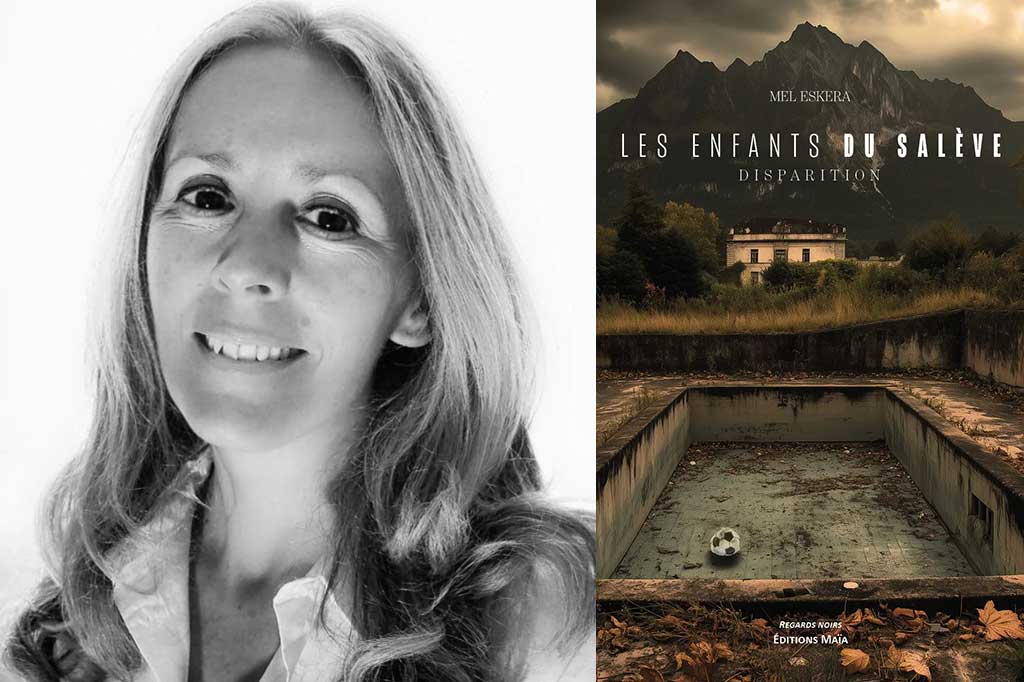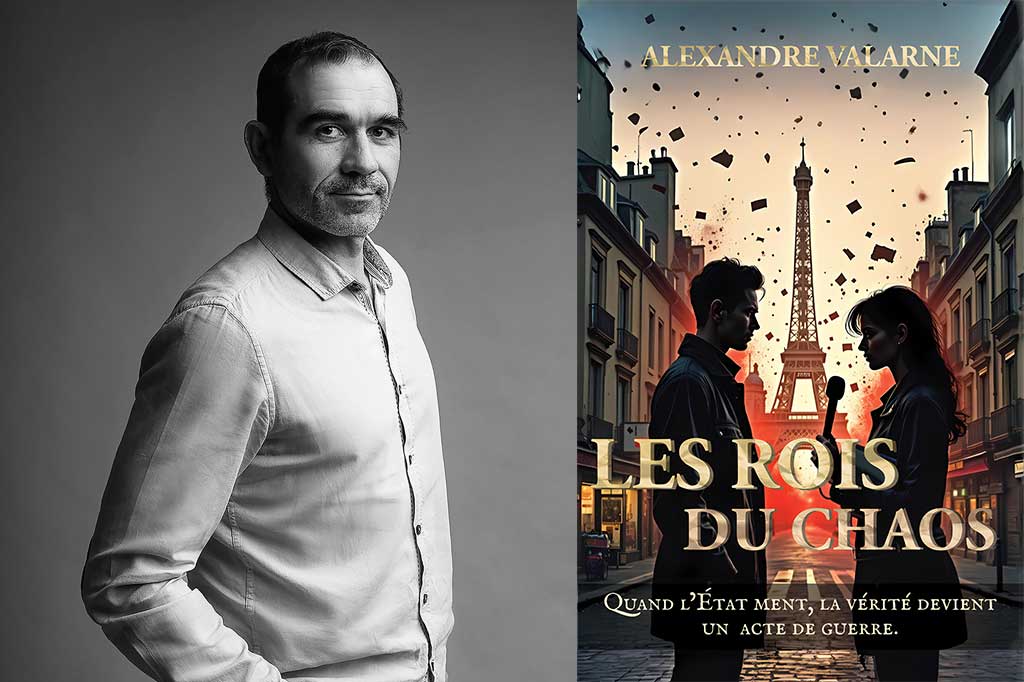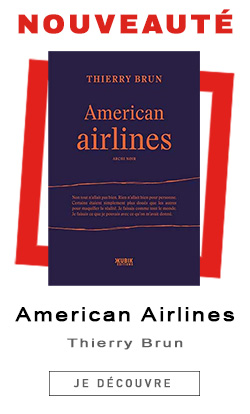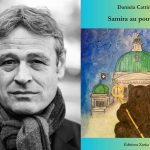Un thriller historique au cœur de la Seconde Guerre mondiale
Soren-Paul Petrek plonge son lecteur dans les dernières années du conflit mondial avec une ambition narrative qui ne laisse guère de répit. Dès le prologue, l’attaque de Pearl Harbor en 1941 sert de détonateur à une intrigue qui s’étendra sur plusieurs continents, tissant un réseau complexe d’opérations militaires, d’espionnage et de recherches scientifiques. L’auteur fait le pari d’embrasser simultanément plusieurs théâtres d’opérations : les laboratoires secrets de Los Alamos, les souterrains de l’usine de Mittelwerk en Allemagne, les bureaux feutrés de Churchill à Londres, et les zones de combat en France et en Pologne. Cette architecture narrative kaléidoscopique permet d’appréhender la guerre comme un phénomène total, où chaque décision prise dans un bureau d’état-major résonne jusqu’aux tranchées et aux laboratoires clandestins.
La dimension historique du roman repose sur un ancrage documentaire tangible. Petrek convoque des personnages réels – Churchill, Oppenheimer, von Braun, Heisenberg – et les inscrit dans une trame fictionnelle qui respecte globalement la chronologie des événements. Les détails techniques concernant le développement des V-2 ou du programme Manhattan témoignent d’un travail de recherche conséquent. L’auteur ne se contente pas de plaquer des noms célèbres sur une intrigue d’espionnage : il tente de restituer les dilemmes scientifiques et stratégiques de l’époque, cette course effrénée vers la maîtrise de l’atome qui hante aussi bien les Alliés que l’Axe.
L’intrigue puise sa force dans l’entrelacement de deux menaces convergentes : la perfection des fusées allemandes et le développement d’armes atomiques. Ce double compte à rebours crée une urgence narrative qui propulse le récit. Les chapitres alternent entre les avancées scientifiques des deux camps, les missions de sabotage menées par le SOE, et les horreurs des camps de concentration où sont assemblées les fusées. Cette structure en mosaïque, si elle exige une certaine concentration du lecteur, permet de saisir la complexité stratégique d’une période où l’innovation technologique basculait dans l’apocalyptique.
Le roman assume pleinement son statut d’uchronie partielle, insérant dans le déroulement historique avéré des éléments spéculatifs qui en densifient la tension. La question centrale – et si l’Allemagne nazie avait réussi à combiner missile balistique et charge atomique ? – n’est pas qu’un artifice dramatique. Elle explore un scénario qui a véritablement hanté les services de renseignement alliés et offre un terrain fertile pour interroger les limites de la guerre totale et les conséquences d’une escalade technologique sans frein.
livres de Soren-Paul Petrek à découvrir
Les enjeux scientifiques et militaires : la course aux armements
Le roman déploie avec minutie les coulisses de ce qui constitue sans doute la compétition technologique la plus déterminante du XXe siècle. Petrek nous fait pénétrer dans les laboratoires secrets où s’affrontent, à distance, les esprits les plus brillants de leur génération. D’un côté, Oppenheimer et son équipe dans le désert du Nouveau-Mexique manipulent le plutonium avec des gestes d’une précision chirurgicale, conscients que la moindre erreur pourrait les pulvériser. De l’autre, Heisenberg perfectionne ses calculs dans les caves d’Haigerloch, poursuivant une quête scientifique dont les implications morales semblent lui échapper totalement. L’auteur parvient à rendre palpables ces abstractions physiques, transformant les équations et les masses critiques en enjeux dramatiques immédiatement compréhensibles.
La dimension technique du récit trouve son pendant dans le développement des V-2, ces fusées que von Braun façonne avec un enthousiasme qui confine à l’aveuglement volontaire. Les scènes à Peenemünde puis à Mittelwerk exposent la machinerie de production de ces missiles, leur assemblage méticuleux par des esclaves affamés, leurs lancements qui oscillent entre échecs spectaculaires et réussites terrifiantes. Petrek ne cache pas les défaillances techniques, les calculs hasardeux, les prototypes qui explosent sur leurs rampes. Cette représentation des tâtonnements scientifiques ajoute une forme d’authenticité au récit : la technologie de pointe n’y est pas magique, elle résulte d’essais, d’erreurs, de corrections infinies. L’image d’un von Braun jetant des dossiers par les fenêtres d’un bâtiment en flammes lors du bombardement de Peenemünde illustre cette fragilité du progrès face au chaos de la guerre.
Ce qui frappe particulièrement dans le traitement de ces enjeux scientifiques, c’est la manière dont l’auteur les connecte aux décisions politiques et militaires. Churchill scrutant un globe terrestre dans son bureau, Roosevelt recevant les lettres d’Einstein, Eisenhower pesant les options de bombardement : ces figures historiques sont montrées dans leur rapport anxieux à une science qu’ils ne maîtrisent pas pleinement mais dont ils comprennent les implications stratégiques. Le roman explore cette tension entre le pouvoir politique et l’expertise scientifique, entre ceux qui décident et ceux qui conçoivent. Les dialogues entre Churchill et le Dr. Chadwick, où le physicien doit expliquer au Premier ministre les principes de la fission nucléaire, incarnent ce fossé entre deux mondes qui doivent pourtant collaborer.
L’hypothèse centrale du roman – la possibilité pour l’Allemagne nazie de placer une charge atomique dans un V-2 à longue portée – n’est pas une pure fantaisie. Petrek s’appuie sur les recherches historiques qui montrent que les scientifiques allemands travaillaient effectivement sur un programme nucléaire, même s’il n’aboutit jamais. Cette proximité avec la réalité historique donne au récit une dimension vertigineuse : nous savons que cette catastrophe a été évitée de peu, mais le roman nous rappelle à quel point l’issue aurait pu être différente. La course aux armements y apparaît pour ce qu’elle fut : un pari démentiel dont l’humanité entière était l’enjeu, joué par des hommes qui n’étaient pas certains de leurs calculs et qui, pour certains, continuaient à travailler en se demandant si leur bombe n’allait pas embraser l’atmosphère terrestre.
Portraits croisés : espions, scientifiques et résistants
Au centre de l’échiquier narratif se tient Madeleine Toche, agent du SOE surnommée « l’Ange de la Mort » par ses ennemis. Petrek construit ce personnage avec une économie de moyens qui évite l’écueil de la sur-caractérisation. Madeleine tue avec une efficacité mécanique, infiltre les installations nazies sans état d’âme apparent, et accumule les missions périlleuses. L’auteur résiste à la tentation d’en faire une héroïne invincible : elle doute, elle fatigue, elle aspire à retrouver une vie normale auprès de Jack Teach, son époux et supérieur au SOE. Cette relation amoureuse au sein d’une organisation militaire aurait pu verser dans le sentimentalisme, mais elle demeure esquissée en touches discrètes, moments volés entre deux opérations où l’intimité se réduit à des cigarettes partagées et des silences complices.
Le colonel Berthold Hartmann incarne une figure plus ambiguë, celle du fantôme qui hante les marges du conflit. Ancien héros de la Première Guerre mondiale, juif allemand ayant fui après la déportation de sa famille, il opère en solitaire avec une détermination qui confine à l’obsession vengeresse. Petrek en fait un personnage presque mythique, comparé à un Golem par les prisonniers qu’il vient libérer, doté d’une patience infinie et d’une violence froide. Son infiltration du camp de Dora, où il se glisse parmi les détenus pour organiser leur révolte, constitue l’une des séquences les plus prenantes du roman. La relation entre Hartmann et Madeleine, celle du maître et de l’élève devenue égale, structure la seconde partie du récit et apporte une dimension presque familiale à ces opérations solitaires.
Du côté des scientifiques, l’auteur adopte une approche plus nuancée qu’on pourrait l’attendre. Oppenheimer apparaît rongé par le doute, fumant cigarette sur cigarette dans le désert du Nouveau-Mexique, conscient qu’il pourrait être en train de forger l’arme qui mettra fin à l’humanité. Von Braun, en revanche, est dépeint dans son ambivalence troublante : passionné par la conquête spatiale, il ferme les yeux sur l’horreur des conditions de production de ses fusées, acceptant la mort de milliers d’esclaves comme un prix nécessaire au progrès. Heisenberg reste le plus énigmatique, scientifique brillant dont les motivations demeurent opaques – poursuit-il la connaissance pure ou adhère-t-il véritablement à l’idéologie nazie ? Le roman ne tranche pas définitivement, laissant planer cette incertitude qui correspond d’ailleurs aux débats historiques sur le personnage réel.
Les personnages secondaires, nombreux, ne se réduisent pas à de simples silhouettes fonctionnelles. Michel Depierre, le prisonnier français de Mittelwerk, Michal Kasza, le résistant polonais, ou Nadya Popova, la pilote soviétique des « Sorcières de la Nuit », apportent des perspectives variées sur le conflit. Petrek leur accorde suffisamment d’épaisseur pour qu’ils ne soient pas de simples faire-valoir des protagonistes principaux. La scène où Nadya transporte Madeleine et Dupont à travers les lignes ennemies, échangeant avec la Française sur leurs projets d’après-guerre, offre un rare moment de légèreté dans un récit autrement tendu. Ces personnages incarnent également les différentes formes de résistance face à l’oppression : la lutte armée, le sabotage, la survie obstinée, chacune avec sa dignité propre.
A lire aussi

« La Secte » : Un polar danois qui décortique les nouveaux visages du pouvoir

L’espionnage russe sous l’œil de Chloé Archambault : une révélation littéraire

« Entre les gouttes » : portrait d’un homme ordinaire aux pulsions extraordinaires

« La Taverne du Bagne » : Hervé Devred réinvente le polar historique
La dimension documentaire et la reconstitution historique
L’armature documentaire du roman repose sur une recherche visible dans le traitement des lieux et des procédures. La description de l’unité d’interprétation photographique de la RAF à Medmenham, où des analystes scrutent des clichés aériens au stéréoscope pour détecter les installations ennemies, s’appuie manifestement sur des sources historiques précises. Petrek restitue l’atmosphère informelle de ce centre où scientifiques, artistes et militaires collaborent dans un désordre apparent, loin du protocole rigide qu’on associe habituellement aux institutions de guerre. De même, les détails concernant le fonctionnement du SOE, ses méthodes de parachutage, ses codes de transmission radio, témoignent d’une familiarité avec l’histoire du renseignement britannique. L’auteur ne se contente pas de plaquer des noms d’institutions : il en décrit les rouages internes, les tensions bureaucratiques, les rivalités entre services.
Les descriptions techniques des V-2 et du programme Manhattan oscillent entre vulgarisation accessible et précision qui peut parfois ralentir le rythme. Lorsque les personnages discutent de masses critiques, de gyroscopes ou d’implosion, le roman bascule momentanément dans un registre presque didactique. Ces passages fonctionnent mieux quand ils sont ancrés dans l’action – von Braun observant l’échec d’un lancement pour comprendre les défaillances de sa fusée – que lorsqu’ils prennent la forme de dialogues explicatifs entre scientifiques. On sent l’auteur tiraillé entre sa volonté de rendre justice à la complexité technique et la nécessité de maintenir la dynamique narrative. Cette tension n’est jamais totalement résolue, mais elle témoigne d’une ambition louable : celle de ne pas réduire la science à un simple décor exotique.
La reconstitution des lieux frappe par sa diversité géographique et son souci du détail matériel. Le désert du Nouveau-Mexique avec sa chaleur écrasante, les souterrains humides de Mittelwerk où la poussière de gypse étouffe les prisonniers, les bureaux lambrissés de Churchill au 10 Downing Street, les forêts polonaises où opèrent les résistants : chaque espace possède sa texture propre. L’auteur sait évoquer les odeurs – celle, insoutenable, des camps de concentration revient comme un leitmotiv horrifié – et les sensations physiques qui ancrent les personnages dans leur environnement. La scène où Madeleine, infiltrée dans la Coupole, se déplace entre les fusées dans l’obscurité, illustre cette capacité à créer une atmosphère tangible à partir d’éléments architecturaux et sensoriels.
Certaines libertés prises avec la chronologie historique méritent d’être mentionnées. Le roman compresse des événements qui se sont étalés sur plusieurs années, accélère certains développements scientifiques, et invente des rencontres qui n’ont probablement jamais eu lieu. Ces ajustements relèvent de la licence romanesque et ne posent pas problème en soi, mais le lecteur averti reconnaîtra des simplifications qui servent la cohérence narrative au détriment de la stricte exactitude historique. L’essentiel demeure : Petrek ne trahit pas l’esprit de l’époque, même s’il en réarrange parfois les détails pour les besoins de son intrigue.
Tension narrative et construction du suspense
La structure en chapitres courts et en perspectives multiples génère un rythme saccadé qui mime l’urgence du temps de guerre. Petrek pratique le montage alterné avec une systématicité qui peut parfois donner l’impression d’un feuilleton télévisé : une scène s’interrompt au moment critique pour basculer vers un autre théâtre d’opérations, laissant le lecteur en suspens. Cette technique éprouvée fonctionne inégalement selon les séquences. Les infiltrations de Madeleine dans les installations nazies bénéficient de cette fragmentation qui amplifie la tension, chaque coup d’œil d’un garde, chaque porte qui grince devenant un péril immédiat. En revanche, les passages consacrés aux délibérations scientifiques ou aux réunions politiques souffrent davantage de ces interruptions, car ils nécessitent une continuité intellectuelle que les allers-retours compromettent.
Le suspense repose largement sur l’ignorance stratégique des protagonistes concernant les avancées de l’adversaire. Oppenheimer se demande où en est Heisenberg, tandis que ce dernier ignore que les Américains ont résolu le problème de la masse critique. Churchill craint que les Allemands ne combinent missile et bombe atomique sans savoir précisément où ils en sont. Cette multiplication des points aveugles crée une angoisse diffuse qui traverse le récit. L’ironie dramatique joue pleinement : le lecteur, qui dispose d’une vision panoramique, mesure à quel point les deux camps sont proches du gouffre sans nécessairement le réaliser. Les scènes où von Braun livre une ogive destinée à recevoir une charge atomique, observé par un prisonnier qui en comprend vaguement les implications, illustrent cette mécanique du suspense fondée sur la circulation imparfaite de l’information.
Les séquences d’action proprement dites s’enchaînent avec une efficacité certaine, même si l’écriture privilégie la clarté descriptive à l’inventivité stylistique. L’infiltration de Madeleine dans l’installation polonaise, son assassinat froid des gardes, la course contre la montre avant l’explosion : ces moments fonctionnent parce qu’ils sont construits avec une logique procédurale rigoureuse. Petrek détaille les gestes techniques – crocheter une serrure, placer un détonateur, calculer le temps de fuite – qui confèrent une crédibilité aux exploits de ses personnages. On est loin de l’espion invincible qui traverse les balles : Madeleine réussit parce qu’elle planifie, anticipe, agit méthodiquement. Cette approche quasi-professionnelle des opérations clandestines rappelle davantage le travail de John le Carré que celui d’Ian Fleming.
Le compte à rebours final vers la destruction de Mittelwerk constitue le climax vers lequel converge l’ensemble des intrigues. Les préparatifs d’Hartmann dans le camp, l’arrivée de Madeleine, la distribution clandestine d’armes et de nourriture aux prisonniers : ces éléments s’assemblent avec la précision d’un mécanisme d’horlogerie. L’extrait fourni s’arrête précisément avant le déclenchement de l’assaut, laissant en suspens l’issue de cette opération qui doit conjuguer sabotage industriel, révolte de prisonniers et exfiltration. Cette construction dramatique témoigne d’une maîtrise des conventions du thriller, même si elle reste tributaire d’une certaine prévisibilité inhérente au genre.
Les meilleurs polars à dévorer chez amazon
Les dilemmes moraux face à l’horreur
Le roman ne détourne jamais le regard de l’horreur concentrationnaire, et c’est peut-être là que réside sa dimension la plus inconfortable. Les descriptions des camps de Dora et de Nordhausen ne cèdent pas au voyeurisme, mais elles n’édulcorent rien non plus : les corps réduits à des squelettes, la dysenterie généralisée, les poux, les pendaisons publiques, la récupération du gras des cadavres pour la fabrication de munitions. Petrek confronte ses personnages – et ses lecteurs – à cette réalité que les dirigeants alliés connaissaient depuis longtemps sans agir directement pour y mettre fin. La puanteur qui enveloppe le camp, décrite de manière obsédante, devient une métaphore de l’impossible ignorance : on ne peut pas prétendre ne pas savoir ce qui se passe quand l’odeur vous assaille à des kilomètres à la ronde.
La question morale centrale traverse plusieurs personnages avec des intensités variables. Oppenheimer est rongé par le doute, conscient qu’il forge potentiellement l’instrument de l’apocalypse, se demandant si leur test ne va pas embraser l’atmosphère terrestre. Von Braun incarne l’aveuglement volontaire du scientifique fasciné par son objet au point de devenir complice de crimes de masse. Heisenberg demeure plus énigmatique, et le roman résiste à la tentation de le diaboliser simplement : est-il un opportuniste cynique ou un homme prisonnier de ses abstractions, incapable de mesurer les implications concrètes de ses travaux ? Cette ambiguïté reflète d’ailleurs les débats historiographiques réels sur les motivations du physicien allemand. Le texte suggère que la passion scientifique peut fonctionner comme un anesthésiant moral, permettant de dissocier l’élégance d’une équation des montagnes de cadavres qu’elle pourrait engendrer.
Hartmann et Madeleine posent d’autres questions éthiques, celles de la violence justifiée et de la vengeance. Hartmann tue méthodiquement, avec une efficacité qui efface toute distinction entre justice et vendetta personnelle. Sa comparaison avec un Golem – créature sans âme dédiée à la destruction des ennemis – n’est pas anodine : il s’est dépouillé de son humanité pour devenir un instrument de mort. Madeleine assassine des gardes d’un coup de stylo dans l’oreille, sans état d’âme apparent, et le roman ne romantise pas cette violence. L’auteur évite cependant le piège du nihilisme : ces actes restent ancrés dans une logique de résistance face à une barbarie qui les dépasse. La scène où Hartmann distribue de la nourriture aux prisonniers, préparant leur évasion tout en sachant qu’ils devront tuer leurs gardiens, illustre cette zone grise où la survie et la dignité s’achètent au prix du sang.
Le roman pose également la question de la responsabilité collective et du silence complice. Comment les habitants de Nordhausen peuvent-ils ignorer l’existence du camp si proche, dont l’odeur infecte empoisonne l’air ? Comment les scientifiques peuvent-ils continuer leurs calculs en sachant qu’ils préparent l’anéantissement de populations entières ? Petrek n’offre pas de réponses définitives, mais il expose ces contradictions sans complaisance. Le Churchill du roman, informé depuis longtemps de l’extermination des juifs mais privilégiant la victoire militaire avant toute tentative de sauvetage, incarne cette logique implacable du moindre mal qui caractérise les décisions en temps de guerre. Ces questions résonnent au-delà du contexte historique particulier et interrogent les compromis que les sociétés acceptent face à l’urgence existentielle.
L’écriture au service de l’action
La prose de Petrek privilégie l’efficacité narrative à l’ornementation stylistique. Les phrases sont généralement courtes, les descriptions fonctionnelles, le vocabulaire précis sans être recherché. Cette économie de moyens convient parfaitement aux séquences d’infiltration et de combat où chaque geste compte, où l’urgence ne tolère pas les digressions. Lorsque Madeleine se faufile dans l’installation polonaise, l’écriture suit ses mouvements avec une netteté quasi-cinématographique : elle crochète une serrure, place un explosif, tue deux gardes, sort. Pas de fioritures, pas de métaphores alambiquées, juste la mécanique de l’action restituée avec une précision qui permet au lecteur de visualiser immédiatement la scène. Cette approche directe rappelle le style journalistique ou le rapport de mission, ce qui renforce paradoxalement l’impression d’authenticité.
Cette sobriété trouve néanmoins ses limites dans les passages plus introspectifs ou les dialogues à visée explicative. Les conversations entre scientifiques, où ils s’expliquent mutuellement des concepts qu’ils sont censés tous maîtriser, trahissent parfois leur fonction didactique. De même, certains moments de doute des personnages sont exprimés de manière un peu mécanique, comme si l’auteur cochait une case obligatoire du développement psychologique sans vraiment s’y attarder. Oppenheimer qui fume en contemplant le désert et se demande s’il sera considéré comme un paria : la scène fonctionne, mais elle reste en surface, n’explorant pas véritablement les abîmes moraux qu’elle suggère. On sent que l’ambition première du roman est de raconter une histoire palpitante plutôt que de sonder les profondeurs de la conscience humaine, ce qui constitue un choix légitime mais qui délimite aussi son territoire.
Les dialogues oscillent entre une vivacité bienvenue et une rigidité occasionnelle. Les échanges entre Madeleine et Hartmann possèdent une densité laconique qui sied à ces professionnels de la clandestinité. En revanche, certaines répliques de Churchill ou d’Eisenhower sonnent comme des résumés historiques déclamés, servant davantage à transmettre de l’information qu’à caractériser véritablement les personnages. La langue traduite de l’américain par Claire Pellissier conserve une certaine fluidité, même si on détecte par endroits des tournures qui trahissent l’original anglophone. Ces aspérités n’entravent jamais vraiment la lecture, mais elles rappellent que le texte porte les traces de son passage d’une langue à l’autre.
Le traitement du temps narratif mérite attention. Petrek compresse parfois des journées en quelques lignes, puis s’attarde pendant plusieurs pages sur une infiltration qui ne dure que quelques minutes. Cette élasticité temporelle, typique du thriller, permet de maintenir un rythme soutenu tout en accordant à chaque séquence l’espace nécessaire à son développement. Les ellipses sont généralement bien négociées, même si quelques transitions paraissent un peu abruptes, nous projetant d’un continent à l’autre sans transition ménagée. L’ensemble demeure néanmoins cohérent, porté par une architecture narrative qui sait où elle va et qui y conduit le lecteur avec une détermination qui ne faiblit guère sur plusieurs centaines de pages.
Les meilleurs polars à dévorer
Un roman qui interroge notre rapport à l’Histoire
« Des loups à notre porte » s’inscrit dans cette tradition du roman historique qui utilise la fiction pour explorer les zones d’ombre et les possibles non advenus du passé. En insérant une hypothèse uchronique – la combinaison d’un missile balistique et d’une charge atomique par l’Allemagne nazie – au sein d’événements historiques avérés, Petrek invite à réfléchir sur la fragilité des issues historiques. Le roman rappelle que la victoire alliée ne relevait pas de l’inéluctable, qu’elle a dépendu de décisions individuelles, de hasards technologiques, de quelques mois d’avance dans une course contre la montre. Cette perspective vertigineuse transforme notre regard rétrospectif : nous contemplons l’Histoire non plus comme un déroulement nécessaire, mais comme un équilibre précaire qui aurait pu basculer autrement.
La coexistence de personnages historiques et fictifs pose la question classique de la légitimité romanesque. Peut-on faire parler Churchill, Oppenheimer ou Heisenberg, leur prêter des pensées, des doutes, des conversations qui n’ont probablement jamais eu lieu ? Petrek assume ce mélange sans états d’âme excessifs, considérant manifestement que le roman historique possède cette prérogative tant qu’il respecte l’esprit général de l’époque et ne déforme pas radicalement les personnalités connues. Le Churchill du roman demeure reconnaissable dans son obstination, son cynisme stratégique, ses cigares omniprésents. Les scientifiques conservent leurs traits caractéristiques tels que les sources historiques les décrivent. Cette fidélité permet au récit de fonctionner sans trahir fondamentalement la mémoire historique, même si elle prend évidemment des libertés avec les détails.
Le roman fonctionne également comme une réflexion sur les usages de la connaissance scientifique et la responsabilité des savants face au pouvoir politique. La figure d’Oppenheimer, rongé par le doute mais poursuivant néanmoins son travail, incarne cette tension entre curiosité intellectuelle et conscience morale. Von Braun représente le scientifique qui choisit de ne pas voir, dont la passion pour les étoiles justifie à ses yeux la collaboration avec la barbarie. Ces portraits ne sont pas neufs – la littérature sur le sujet est abondante – mais leur insertion dans une trame de thriller permet de les rendre accessibles à un public plus large. Le roman pose ainsi la question de la neutralité scientifique : peut-on séparer la beauté d’une équation des cadavres qu’elle peut générer ? La science est-elle moralement neutre ou les scientifiques portent-ils une responsabilité spécifique dans les usages qui sont faits de leurs découvertes ?
Au-delà de ces interrogations philosophiques, « Des loups à notre porte » offre surtout une porte d’entrée narrative dans une période historique complexe. Pour le lecteur déjà familier avec la Seconde Guerre mondiale, il propose un angle spécifique – celui de la course aux armements technologiques – traité avec suffisamment de sérieux documentaire pour nourrir sa réflexion. Pour celui qui découvrirait cette histoire, le roman peut fonctionner comme un stimulant, une invitation à creuser davantage ces questions dans des ouvrages plus académiques. Cette ambition de vulgarisation accessible, sans être la plus haute fonction de la littérature, possède sa légitimité propre et « Des loups à notre porte » l’assume pleinement, offrant un récit qui divertit tout en instruisant, qui fait frissonner tout en documentant. C’est un équilibre difficile que Petrek parvient à maintenir sur la longueur d’un roman conséquent, et c’est déjà un accomplissement notable.
Mots-clés : Thriller historique, Seconde Guerre mondiale, Bombe atomique, Espionnage, SOE, V-2, Camps de concentration
Extrait Première Page du livre
» PROLOGUE
7 Décembre 1941
Les chasseurs arrivèrent au-dessus de la flotte américaine du Pacifique à Pearl Harbor sans avoir été repéré. La plupart portaient des torpilles. Ils avaient décollé à des kilomètres de là, après une longue navigation depuis le Japon. Il s’agissait d’une attaque surprise dans l’espoir que les États-Unis consentiraient à un traité acceptable, laissant le Japon libre de s’emparer de l’Asie du Sud-Est. Mais rien ne se passerait comme prévu.
Le matin était vif et lumineux. Les hommes et les femmes se réveillèrent en entendant un bruit d’avions venant de la mer. Le personnel médical s’attendait à un autre jour au paradis. Cuirassés et porte-avions étaient ancrés dans les tranquilles eaux turquoise du port naturel qu’offrait l’île.
Lorsque les sirènes retentirent, curieux, les gens sortirent de leurs maisons ou de leurs bureaux. Les yeux rivés vers le ciel, ils regardaient d’étranges avions tourner à basse altitude et larguer des bombes.
Ce qui ressemblait à un paysage de carte postale se transforma en chaos. Des infirmières en maillot de bain couraient depuis la plage à la recherche de blessés. Les quelques pilotes stationnés dans les environs se hâtèrent vers leurs avions pour riposter. Certains purent décoller. D’autres furent tués au sol, brûlés vifs dans leur cockpit.
Le président Roosevelt soumit au Congrès une déclaration de guerre : demande aussitôt ratifiée.
Bureau du Président des États Unis
La Maison Blanche, Washington, DC
Juin 1942.
Franklin Delano Roosevelt était assis derrière son bureau à la Maison Blanche. Sa table était éclairée par une petite lampe. Le bureau ovale était plongé dans la pénombre. Il était tard. Il attendait un coup de fil de Leslie Groves, l’un de ses généraux. Rien n’était plus important. «
- Titre : Des loups à notre porte
- Titre original : Wolves at Our Doors
- Auteur : Soren-Paul Petrek
- Traduction : Claire Pellissier
- Éditeur : Audible Amazon
- Nationalité : États-Unis
- Date de sortie en France : 2022
Page officielle : www.sorenpetrek.com
Résumé
Alors que les Alliés et les nazis se livrent une lutte incessante, une pluie de missiles supersoniques V2 s’abat sur Londres, où s’accumulent les corps sans vie d’innocents. Pourtant, en plein territoire allemand, un projet destiné à mettre brutalement fin à la guerre, et à renverser la défaite certaine des nazis en une victoire totale, inquiète d’avantage Madeleine Toche, la terreur absolue des nazis, et Berthold Hartmann, l’assassin allemand qui lui a appris à tuer. Ce projet n’est autre que la bombe atomique.
Ensemble, ils se précipitent en plein cœur de l’Allemagne à la recherche de l’usine secrète : un camp de concentration où les déportés juifs semblent construire sous la contrainte les missiles V2… L’avenir du monde est entre leurs mains.
Inspiré par ces centaines de femmes qui ont eut un rôle essentiel dans les campagnes militaires, Soren Petrek revisite son personnage phare : Madeleine Toche. Ainsi, à travers une héroïne limitée seulement par son courage exceptionnel, il offre une visibilité à toutes ces femmes de l’ombre, dont l’histoire ne sera jamais racontée.
Qu’elle soit précipitée dans les combats de la Seconde Guerre mondiale, investie dans la Résistance, recrutée par les services secrets britanniques, devenue la terreur absolue des SS ou de la Gestapo, qu’elle plonge au cœur de l’Allemagne nazie pour empêcher un conflit nucléaire, ou qu’elle intervienne pour sauver ses proches au Moyen-Orient : Madeleine Toche ne perd jamais de vue ses valeurs les plus chères ; et à chaque instant rappelle que toute la force et l’esprit humain brille dans les actes de justice et de bravoure.
Inspiré par les histoires de sacrifices qu’on lui a contées étant jeune, Soren Petrek donne ainsi une voix à ces femmes de l’ombre qui jouèrent un rôle cruciale lors des périodes les plus sombres de l’histoire.
Soren Petrek est avocat et auteur américain passionné par la Seconde Guerre mondiale. Il a grandi en France et en Angleterre, en écoutant les histoires des hommes et des femmes qui se sont sacrifiés et luttés lors d’une des périodes les plus tragiques de tous les temps. S’inspirant en outre de ses recherches historiques, sa poésie et ses romans reflètent l’horreur de la guerre, et mettent à l’honneur les actes de bravoure des hommes et des femmes. Il est, entre autres, l’auteur de la série à succès Madeleine Toch. Marié et père de deux enfants, il vit et travaille à St. Paul, dans le Minnesota.
D’autres chroniques de livres de Soren-Paul Petrek

Je m’appelle Manuel et je suis passionné par les polars depuis une soixantaine d’années, une passion qui ne montre aucun signe d’essoufflement.